À l’occasion de la Journée mondiale de l’audition, cet article traite de la relation entre l’audition et le cerveau, en mettant particulièrement l’accent sur la manière dont la perte auditive affecte les fonctions cognitives et les stratégies de réhabilitation auditive qui peuvent être adoptées.
Introduction
Le 3 mars de chaque année est commémoré la Journée mondiale de l’audition, une initiative lancée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour sensibiliser à l’importance de la santé auditive et à la prévention des troubles auditifs (World Health Organization, 2023). Dans le domaine de la neuroréhabilitation, l’audition joue un rôle crucial dans le traitement cognitif, la communication et la qualité de vie.
Des études récentes ont montré que la perte auditive n’affecte pas seulement la perception des sons, mais qu’elle peut impacter négativement la mémoire, l’attention et d’autres fonctions cognitives clés (Lin et al., 2013).
Cet article explore la connexion entre l’audition et le cerveau, les effets de l’hypoacousie sur le fonctionnement cérébral et les stratégies de réhabilitation auditive dans le cadre de la stimulation cognitive.
La connexion entre l’audition et le cerveau
Le système auditif humain est un processus neurosensoriel complexe qui n’implique pas seulement les oreilles, mais également d’autres structures cérébrales essentielles à la perception des sons et à la communication (Peelle et al., 2010).
Lorsque l’oreille capte un son, les ondes sonores se transforment en signaux électriques qui voyagent via le nerf auditif jusqu’au cortex auditif, situé dans le lobe temporal du cerveau. Cette zone est essentielle pour interpréter la signification des sons, reconnaître les voix et comprendre le langage.
Ce processus implique des structures clés telles que :
- Oreille externe, moyenne et interne, chargées de capter et transmettre les ondes sonores.
- Nerf auditif, qui transporte l’information vers le cerveau.
- Cortex auditif, situé dans le lobe temporal, où les sons sont traités et interprétés.
De plus, l’audition est étroitement liée à d’autres fonctions cognitives. Des études ont montré que la perte auditive non traitée peut accélérer le déclin cognitif et augmenter le risque de démence (Livingston et al., 2020). Cela pourrait être dû à la surcharge cognitive nécessaire pour compenser la perte auditive, ainsi qu’à la diminution de la stimulation cérébrale et de l’interaction sociale (Oxford University, 2021).
Lorsque ce système est perturbé par la perte auditive, le cerveau doit compenser le déficit en redistribuant les ressources pour interpréter les sons avec moins d’efficacité. Des recherches suggèrent que cet effort supplémentaire peut engendrer une surcharge cognitive et provoquer un déclin d’autres fonctions cérébrales (Lin et al., 2013).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Impact de la perte auditive sur la fonction cognitive
La perte auditive n’affecte pas seulement la capacité d’écoute, elle a également un impact significatif sur la fonction cognitive. Lorsque le cerveau reçoit moins de stimuli auditifs, la capacité de traitement et les fonctions cérébrales associées, telles que la mémoire et l’attention, peuvent être altérées (Arlinger, 2003). Le manque de stimulation auditive réduit l’activation de certaines zones cérébrales, ce qui peut entraîner une baisse de l’efficacité cognitive.
Plusieurs études et recherches scientifiques ont mis en évidence une corrélation entre la perte auditive et le déclin cognitif, en particulier chez les personnes âgées (Livingston et al., 2020).
Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette corrélation, notamment l’évitement des interactions sociales. Cependant, cela peut conduire à un isolement social qui, associé à la charge cognitive supplémentaire liée à la tentative de compréhension des sons, génèrerait un stress mental accélérant le déclin cognitif (Oxford University, 2023).
Stratégies de réhabilitation auditive
La réhabilitation auditive va au-delà de la simple restauration de l’écoute, elle implique également d’atténuer les effets négatifs de la perte auditive sur la cognition et de renforcer la connexion entre l’audition et le cerveau.
Pour y parvenir, il est essentiel de mettre en place des stratégies favorisant la stimulation cérébrale et améliorant la communication. Parmi les plus efficaces figurent l’utilisation d’appareils auditifs, la réalisation de thérapies spécialisées en réhabilitation auditive et stimulation cognitive ciblée, ainsi que l’adoption d’habitudes saines renforçant le traitement du son.
1. Utilisation d’appareils auditifs pour la réhabilitation auditive
Les appareils auditifs jouent un rôle clé dans la réhabilitation auditive, car ils non seulement améliorent la capacité d’écoute, mais stimulent également le cerveau, contribuant à prévenir le déclin cognitif associé à la perte auditive (Lin et al., 2013).
La technologie a considérablement progressé dans ce domaine, proposant des solutions personnalisées pour chaque type d’hypoacousie.
L’utilisation d’aides auditives ou d’implants cochléaires aide à stimuler le système auditif, à améliorer la perception des sons, à éviter la privation sonore et, en fin de compte, à réduire la charge cognitive du cerveau.
L’utilisation d’appareils auditifs ne contribue pas seulement à compenser la perte auditive, elle renforce également la connexion entre l’audition et le cerveau, améliorant la qualité de vie et prévenant l’isolement social.
Plusieurs recherches confirment que protéger l’audition à l’aide de protections auditives dans les environnements bruyants ou l’adoption d’aides auditives peut prévenir ou réduire le risque de démence. Cependant, il faut garder à l’esprit que le processus d’adaptation à ces dispositifs demande du temps et un entraînement pour optimiser leur efficacité.
Quels dispositifs auditifs peut-on utiliser pour la réhabilitation auditive ?
1. Utilisation d’appareils auditifs pour la réhabilitation cognitive
Les appareils auditifs amplifient les sons et améliorent la perception de la parole, facilitant la communication dans divers environnements. Il existe des modèles numériques qui s’adaptent automatiquement aux variations de volume et réduisent le bruit ambiant, offrant une expérience auditive plus claire et naturelle.
2. Utilisation d’implants cochléaires pour la réhabilitation auditive
Pour les personnes atteintes d’une perte auditive sévère ou profonde, les implants cochléaires constituent une alternative efficace. Ces dispositifs transforment le son en signaux électriques qui stimulent directement le nerf auditif, restaurant la perception auditive même dans les cas où les appareils auditifs ne suffisent pas.
2. Thérapies de stimulation cognitive pour la réhabilitation auditive
Par ailleurs, la réhabilitation auditive ne dépend pas uniquement de l’utilisation d’appareils auditifs tels que les aides auditives ou les implants cochléaires, elle requiert également une approche globale dans laquelle la stimulation cognitive joue un rôle clé.
Les thérapies de stimulation cognitive aident à renforcer des fonctions clés telles que la mémoire auditive, l’attention sélective et la vitesse de traitement auditif, optimisant la capacité à comprendre la parole, notamment dans des environnements difficiles (Peelle et al., 2010).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
À cet égard, des séances de stimulation cognitive axées sur la lecture à voix haute, l’écoute active de musique et la réalisation de jeux de mémoire auditive favorisent l’intégration du son avec d’autres fonctions cognitives, améliorant l’attention et la compréhension verbale, en plus de renforcer les connexions neuronales responsables du traitement auditif.
Parmi les techniques utilisées, on distingue :
- Exercices de discrimination auditive, visant à entraîner le cerveau à différencier des sons similaires, facilitant ainsi la compréhension de la parole.
- Activités de mémoire, axées sur le renforcement de la capacité à mémoriser et à traiter l’information auditive.
- Jeux d’attention sélective, conçus pour aider à se concentrer sur des sons spécifiques dans des environnements bruyants.
- Exercices de traitement phonologique, visant à améliorer l’identification et la production des sons du langage.
- Activités de latéralisation et/ou localisation des sons, qui aident à déterminer l’origine de chaque son.
Activités de la vie quotidienne (AVQ)
Les activités de la vie quotidienne (AVQ) sont essentielles pour renforcer les compétences acquises lors des entraînements auditifs ; car leur altération et leur perte sont des signes de trouble cognitif léger (TCL).
Des activités telles que la communication quotidienne, l’interaction dans des environnements sociaux, les courses ou l’organisation du foyer peuvent être entraînées pour faciliter le traitement auditif dans les situations de tous les jours. L’intégration de ces tâches au quotidien favorise la généralisation des compétences acquises, encourage l’autonomie et améliore la capacité d’écoute dans des contextes naturels.
Bénéfices des thérapies de stimulation cognitive pour la réhabilitation auditive
1. Amélioration du traitement auditif
La stimulation cognitive renforce des compétences telles que la mémoire de travail, l’attention sélective et la vitesse de traitement, facilitant l’interprétation des sons et la reconnaissance de la parole, notamment dans des environnements bruyants.
2. Compensation des déficits auditifs
Les personnes souffrant de perte auditive développent souvent des stratégies cognitives pour compenser la diminution de la perception sonore. Les exercices de stimulation cognitive renforcent ces stratégies, favorisant la compréhension du langage même avec une capacité auditive réduite.
3. Réduction de l’effort auditif
La perte auditive implique un effort mental accru pour comprendre les sons. L’entraînement cognitif optimise l’efficacité neuronale, réduisant la fatigue auditive et améliorant la qualité de vie.
4. Prévention du déclin cognitif
La perte auditive non traitée est associée à un risque accru de déclin cognitif. La stimulation de fonctions telles que la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives contribue à prévenir cet impact négatif.
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
3. Promotion d’habitudes saines
La prévention et le soin du système auditif sont essentiels pour éviter la progression de la perte auditive et optimiser les résultats de la réhabilitation (World Health Organization, 2023).
Voici quelques conseils visant à maintenir une bonne santé auditive et cognitive :
- Éviter une exposition prolongée à des bruits forts pouvant accélérer la perte auditive. La modération du volume sur les appareils électroniques peut également réduire le risque de dommages auditifs.
- Maintenir une alimentation équilibrée, riche en antioxydants et en acides gras tels que les oméga-3, le magnésium et les vitamines A, C et E, qui favorisent la santé de l’oreille interne.
- Faire régulièrement de l’exercice physique pour améliorer le flux sanguin de l’oreille interne et réduire le risque de perte auditive liée à l’âge.
- Éviter le tabagisme et la consommation excessive d’alcool, car ces deux facteurs sont liés à un risque accru de détérioration auditive.
- Effectuer des contrôles auditifs réguliers, afin de permettre une détection précoce des problèmes auditifs et de faciliter une intervention adéquate.
Conclusion
La relation entre l’audition et le cerveau est un domaine d’intérêt croissant en neuroréhabilitation. La perte auditive n’affecte pas seulement la perception du son, elle peut également avoir des conséquences sur la mémoire, l’attention et la fonction cognitive en général.
La détection précoce, l’utilisation d’appareils auditifs, les thérapies de stimulation cognitive et la mise en place d’habitudes saines sont des stratégies clés pour atténuer ces effets et améliorer la qualité de vie des patients.
Bibliographie
- Arlinger, S. (2003). Negative consequences of uncorrected hearing loss – A review. International Journal of Audiology, 42(sup2), 17-20.
- Lin, F. R., Yaffe, K., Xia, J., et al. (2013). Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA Internal Medicine, 173(4), 293-299.
- Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., et al. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446.
- Stevenson, J. S., Clifton, L., Kuźma, E., & Littlejohns, T. J. (2022). Speech‐in‐noise hearing impairment is associated with an increased risk of incident dementia in 82,039 UK Biobank participants. Alzheimer’s & Dementia, 18(3), 445-456.
- Stevenson, J., & Littlejohns, T. (21 juillet 2021). Difficulty hearing speech could be a risk factor for dementia. University of Oxford. https://www.ox.ac.uk/news/2021-07-21-difficulty-hearing-speech-could-be-risk-factor-dementia
- Peelle, J. E., Troiani, V., Wingfield, A., & Grossman, M. (2010). Neural processing of speech in aging and hearing loss: Functional MRI evidence of compensatory mechanisms. The Journal of Neuroscience, 30(48), 15250-15258.
- World Health Organization (2023). World Hearing Day: Hearing care for all. Disponible sur : https://www.who.int


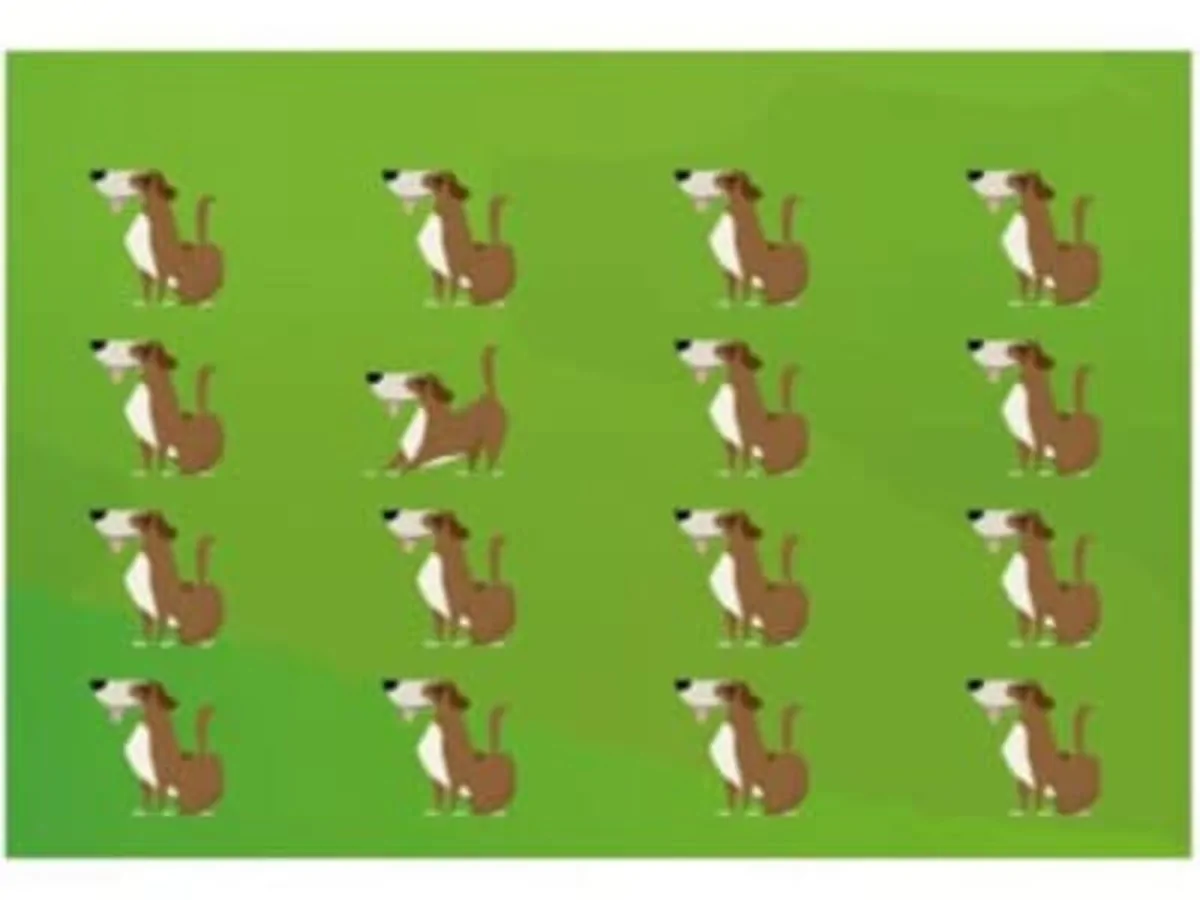
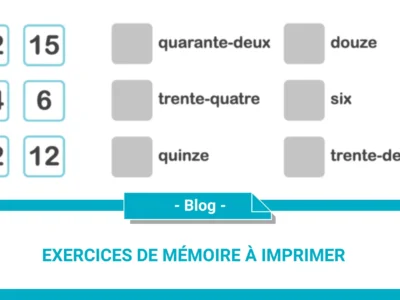




Laisser un commentaire