Manuel Cassinello Marco, psychiatre spécialiste en neuropsychiatrie et psychologue, nous explique dans cet article comment la démence frontotemporale affecte.
Quand nous pensons à la démence, la maladie d’Alzheimer nous vient le plus souvent à l’esprit, mais il existe en réalité de nombreux autres types de tableaux neurodégénératifs. Ils ont en commun une atrophie progressive de différentes régions du cerveau. Parmi eux figure la démence frontotemporale. Il est important de reconnaître les symptômes pour pouvoir consulter des professionnels qui pourront commencer un traitement de réhabilitation au plus tôt.
Dégénérescence et démence frontotemporale
La démence frontotemporale ou maladie de Pick désigne un syndrome clinique dont la présentation principale consiste en une altération de la personnalité associée à des troubles du comportement, des troubles du langage et une détérioration cognitive. Cependant, il est important de la distinguer de la dégénérescence frontotemporale. Cette dernière se réfère uniquement à l’existence d’une atrophie limitée aux lobes préfrontaux et temporaux antérieurs. Autrement dit, il peut y avoir une atrophie sans qu’une clinique de démence soit associée.
La démence frontotemporale, également appelée maladie de Pick, doit son nom à son découvreur, Arnold Pick, et fait référence aux fameux corps de Pick, qui sont des groupes de neurones endommagés dus au dépôt et à l’impossibilité d’élimination de la protéine tau, et s’accompagne d’un phénomène appelé gliosis, qui laisse une lésion similaire à une cicatrice.
Symptômes de la démence frontotemporale
Lorsqu’on évoque la démence frontotemporale, il est important de préciser que nous ne parlons pas d’un seul tableau clinique, mais de différentes entités qui partagent des lésions communes dont la manifestation clinique peut varier. C’est pourquoi, dans cette section, nous devons distinguer entre les trois variantes cliniques principales : la démence frontotemporale à variante comportementale, l’aphasie progressive non fluente et la démence sémantique.
- Variante comportementale : Il s’agit de la variante la plus fréquente et les symptômes habituels sont :
- troubles du comportement,
- changements de personnalité,
- apathie (il convient de rester vigilant car cette présentation est souvent confondue avec un tableau dépressif),
- désinhibition,
- comportements inappropriés,
- déficit de jugement,
- troubles alimentaires tels que l’ingestion de substances non nutritives (par exemple, aliments avariés),
- abandon de l’hygiène et des soins personnels,
- rigidité comportementale,
- irritabilité.
- Aphasie progressive non fluente : Parmi ses symptômes, on retrouve :
- l’anomie ou la difficulté à trouver les mots ou à nommer les objets (c’est le symptôme principal),
- emploi inapproprié des temps verbaux,
- altération de l’ordre des mots,
- erreurs grammaticales plus étendues,
- mutisme (c’est le symptôme final dans l’évolution de cette variante).
- Démence sémantique : Dans cette forme, il est courant que la personne présente :
- des difficultés à comprendre ce qu’elle lit comme ce qu’elle entend,
- des difficultés à nommer ou même à décrire les objets,
- une meilleure conservation de la mémoire autobiographique et des événements, si bien que, malgré une compréhension limitée, elle semble capable de tenir une conversation normale. Cependant, si on l’analyse, cette conversation est « vide » d’informations.
Phases de la démence frontotemporale
Bien que l’évolution de toutes les variantes soit progressive, avec des aggravations occasionnelles dues à des complications telles que des infections, on peut toutefois distinguer, à titre pratique, deux phases :
- Phase 1 ou phase présymptomatique : Au cours de cette phase, on ne retrouve pas les symptômes habituels des différentes formes de présentation. Cependant, on peut observer certains symptômes tels que l’apathie, le désintérêt ou les troubles de l’attention. À ce stade, même si la famille commence à remarquer des situations inhabituelles, elle peut ne pas y accorder trop d’importance en l’absence d’antécédents familiaux.
- Phase 2 ou phase symptomatique : Au cours de cette phase, les symptômes les plus habituels de chaque variante commencent à se manifester. L’évolution annuelle, ainsi que le nombre et l’intensité des symptômes, varie fortement d’une personne à l’autre et dépend, entre autres facteurs, de la survenue de complications telles que des hospitalisations, des infections urinaires, des décompensations d’autres maladies, des changements de domicile, etc. Il est courant que, dans cette phase, on observe une dépendance de plus en plus marquée vis-à-vis des aidants et de la famille.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Causes de la démence frontotemporale
Comme nous l’avons déjà exposé, lorsque l’on parle de démence, on pense généralement à la maladie d’Alzheimer. Cependant, la démence frontotemporale représente environ 5 à 10 % de l’ensemble des démences, ce pourcentage augmentant à un peu plus de 20 % lorsque le tableau débute avant 65 ans. Comme pour la maladie d’Alzheimer, son cours est chronique et progressif.
La démence frontotemporale présente une forte composante génétique, car dans jusqu’à 50 % des cas, on retrouve des antécédents familiaux de démence frontotemporale, de troubles psychiatriques ou de SLA (sclérose latérale amyotrophique). Elle touche les deux sexes à parts égales et a été associée à plusieurs gènes : PGRN (gène de la progranuline) et MAPT (protéine tau associée aux microtubules), tous deux localisés sur le chromosome 17q21. Cela signifie que la démence frontotemporale est héréditaire dans un pourcentage élevé de cas.
Diagnostic de la démence frontotemporale
Comme pour les autres démences, le diagnostic est clinique et nécessite la réalisation de plusieurs examens tels que :
- Analyses sanguines incluant la vitamine B12, l’acide folique, les hormones thyroïdiennes et, de manière générale, tous les paramètres permettant de distinguer cette démence d’une cause réversible.
- Analyse du liquide céphalo-rachidien où l’on mesurera les niveaux de protéine tau afin de différencier cette démence d’une démence de type Alzheimer.
- Études de neuroimagerie telles qu’une IRM cérébrale à la fois anatomique et fonctionnelle, où l’on observera une atrophie des deux lobes frontaux et une activité réduite dans ceux-ci. Parfois, on peut également observer une atrophie des lobes temporaux. Il faut savoir que, n’étant pas un tableau homogène, puisqu’il existe trois formes différentes, il est normal que les résultats en neuroimagerie varient d’une personne à l’autre, ainsi que d’une présentation clinique à une autre.
Traitement de la démence frontotemporale
Malheureusement, à ce jour, il n’existe pas de traitement curatif de la démence frontotemporale, le traitement est uniquement symptomatique. Dans ce sens, les traitements dont nous disposons sont :
- Antidépresseurs : De préférence ceux dits de première ligne ou sérotoninergiques, car dans la zone atteinte par l’atrophie, le déficit en sérotonine est plus important et peut bénéficier de ces traitements.
- Trazodone : Antidépresseur atypique utilisé pour la prise en charge des troubles du comportement et bien toléré.
- Antipsychotiques : À faibles doses, ils aident à améliorer l’irritabilité, les troubles du comportement, les éventuels symptômes psychotiques et l’insomnie.
- En ce qui concerne les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase ou la mémantine, habituellement utilisés dans la maladie d’Alzheimer, il n’existe pas de preuve claire recommandant leur emploi chez les patients atteints de démence frontotemporale.
- Rééducation cognitive : À ce jour, de nombreux programmes de rééducation cognitive existent, qui, bien qu’ils ne modifient pas le cours de la maladie, permettent d’améliorer considérablement la qualité de vie de ces patients en offrant un entraînement guidé par des professionnels des déficits observés.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
En ce qui concerne l’espérance de vie, la fourchette d’années est très large. Toutefois, en général, elle se situe entre deux et dix ans après le diagnostic.
C’est pourquoi il est essentiel de mettre en place une approche multidisciplinaire impliquant neurologues, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychiatres et neuropsychologues. La combinaison de tous ces professionnels a pour objectif de réaliser un traitement approprié, tant pharmacologique que de rééducation, afin d’améliorer la qualité de vie non seulement du patient, mais aussi de ses aidants.
Bibliographie
- Traité de neuropsychogériatrie.
- Neuropsychologie de Javier Tirapu Ustárroz, Marcos Ríos Lago et Fernando Maestú Unturbe.
- Introduction à la psychopathologie et à la psychiatrie de J. Vallejo.
- Maladie d’Alzheimer et autres démences de R. Alberca et S. López-Pouda.
- Psychiatrie gériatrique d’Agüera, Martín et Sánchez.

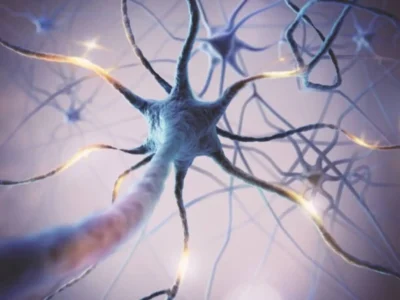




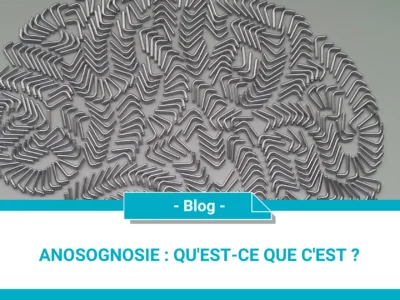
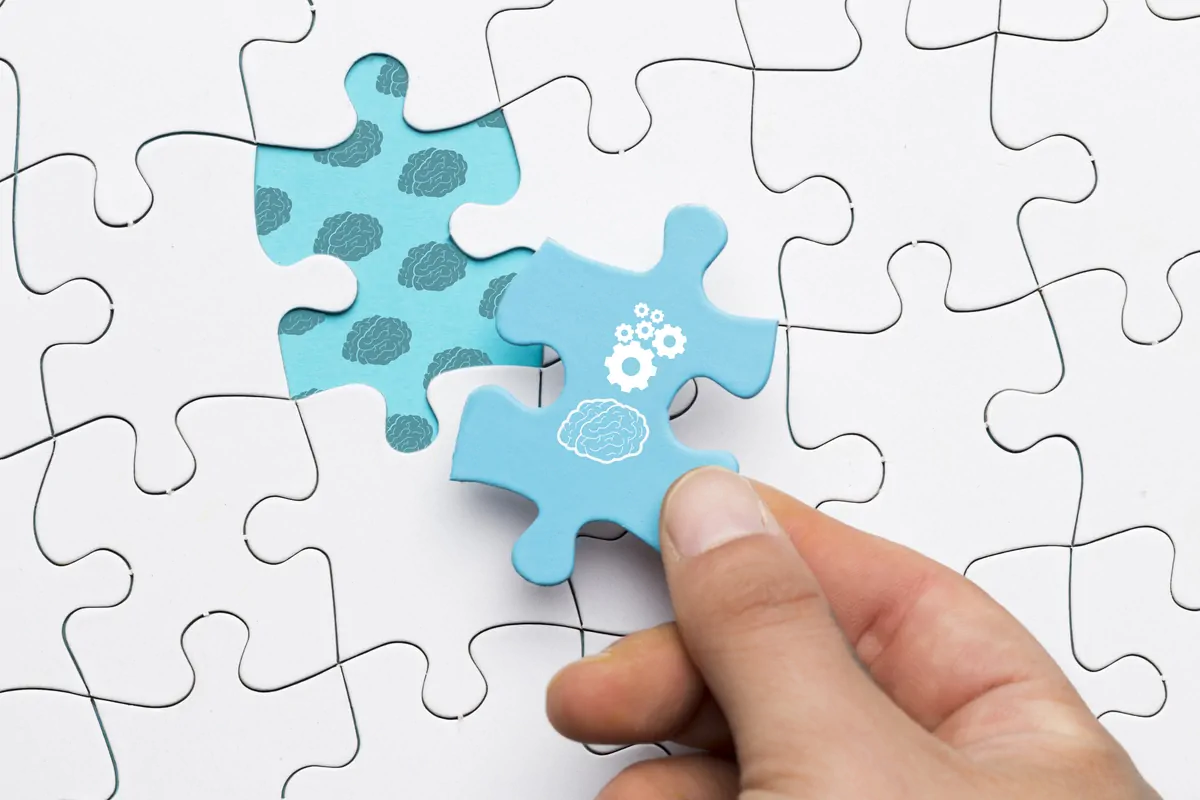 Traitement émotionnel dans la schizophrénie
Traitement émotionnel dans la schizophrénie
Laisser un commentaire