La neuropsychologue Estefanía Lesser nous explique l’impact de la dépression sur la cognition et pourquoi la stimulation cognitive est cruciale pour les personnes âgées souffrant de dépression.
Introduction
Le vieillissement est un processus naturel qui entraîne des transformations biologiques, psychologiques et sociales, dont beaucoup affectent directement la santé mentale des personnes âgées. Dans ce contexte, la dépression chez les personnes âgées est devenue un problème croissant et souvent sous-estimé. Ses manifestations diffèrent souvent de celles observées à d’autres étapes de la vie, et ses effets ne se limitent pas au plan émotionnel, mais impactent également de manière significative les fonctions cognitives, comme la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives.
Malgré sa haute prévalence, la dépression chez les personnes âgées continue d’être sous-diagnostiquée, notamment lorsqu’elle se présente avec des symptômes atypiques ou qu’on la confond avec un trouble cognitif. Cette superposition peut donner lieu à des tableaux tels que la pseudodémence dépressive, où l’atteinte cognitive est secondaire à la dépression et potentiellement réversible. Face à ce panorama, il devient urgent de mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques qui intègrent le traitement émotionnel et la préservation des fonctions cognitives.
Parmi ces stratégies, la stimulation cognitive s’est imposée comme une intervention efficace, soutenue par des preuves scientifiques qui étayent sa capacité à améliorer les performances cognitives, renforcer l’estime de soi, réduire l’isolement et prévenir le déclin neurocognitif. Son impact positif est d’autant plus important lorsqu’elle fait partie d’une approche multidisciplinaire, impliquant neuropsychologues, psychologues cliniciens, ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, psychiatres et aidants.
La dépression chez les personnes âgées et son impact sur la cognition
Qu’est-ce que la dépression
La dépression est un trouble de l’humeur qui implique une combinaison de symptômes émotionnels, physiques et cognitifs, incluant tristesse persistante, perte d’intérêt, troubles du sommeil, fatigue, difficultés de concentration et pensées négatives récurrentes (American Psychiatric Association, 2013). Chez les personnes âgées, ce tableau a tendance à passer inaperçu en raison de manifestations atypiques telles que l’apathie, la lenteur ou les plaintes somatiques (González-Fernández et al., 2020).
Prévalence de la dépression chez les personnes âgées
On estime que la prévalence de la dépression chez les personnes âgées varie entre 10 % et 15 % dans la population générale, mais peut atteindre entre 20 % et 25 % chez les personnes institutionnalisées ou atteintes de maladies chroniques (Pérez-Arechaederra et al., 2018; World Health Organization [WHO], 2017).
Dans le contexte latino-américain, des études comme l’Encuesta SABE en Colombie ont rapporté des prévalences même supérieures à 30 % chez les personnes de plus de 60 ans (Albala et al., 2005).
Identification clinique de la dépression chez les personnes âgées
Pour son identification clinique, on utilise des instruments tels que la Geriatric Depression Scale (GDS), l’Inventaire de dépression de Beck-II adapté aux personnes âgées et des entretiens structurés comme le Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Ces tests permettent un dépistage efficace adapté au profil cognitif et émotionnel de cette population (Yesavage et al., 1982; González et al., 2013).
Symptômes de dépression chez les jeunes adultes et les personnes âgées
Chez les personnes âgées, les symptômes dépressifs peuvent se différencier de ceux observés chez les jeunes adultes. Ils peuvent présenter l’apathie, irritabilité, perte d’énergie, difficultés fonctionnelles, retrait social et plaintes somatiques persistantes (Blazer, 2003; Jeste et al., 1999). Ces symptômes n’affectent pas seulement l’état émotionnel, mais aussi les performances dans les tâches cognitives, en particulier les fonctions exécutives telles que la planification, la mémoire de travail, l’attention soutenue et le contrôle inhibiteur (Butters et al., 2004; Sachs-Ericsson et al., 2011).
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
Qu’est-ce que la pseudodémence dépressive
Une condition pertinente dans ce contexte est la pseudodémence dépressive, un syndrome clinique dans lequel les symptômes dépressifs simulent un trouble cognitif sévère. Contrairement aux démences neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, dans la pseudodémence les déficits cognitifs ne progressent pas et peuvent être réversibles avec un traitement adéquat (Ritchie et al., 1994; Looi & Macfarlane, 2009). Les patients sont souvent conscients de leurs difficultés et ont tendance à les dramatiser, ce qui contraste avec l’anosognosie typique de la démence. Cependant, il est important de souligner que certains patients atteints de pseudodémence peuvent évoluer vers une démence irréversible s’ils ne sont pas pris en charge à temps (Barnes et al., 2006).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Pourquoi la stimulation cognitive est-elle cruciale pour les personnes âgées souffrant de dépression ?
La stimulation cognitive comprend un ensemble de techniques thérapeutiques visant à maintenir ou améliorer le fonctionnement des fonctions cognitives. Chez les personnes âgées déprimées, ces interventions ne sont pas seulement recommandables, mais nécessaires, en raison de leur effet sur de multiples dimensions du bien-être.
1. Neuroplasticité chez les personnes âgées
Bien que la plasticité cérébrale diminue avec l’âge, le cerveau reste capable de s’adapter, de générer de nouvelles connexions synaptiques et de réorganiser des réseaux neuronaux en réponse aux stimuli environnementaux et à l’entraînement cognitif (Park & Bischof, 2013; Draganski & May, 2008). Ce principe soutient l’efficacité de la stimulation cognitive, en favorisant la activation des zones affectées par la dépression et en compensant les fonctions altérées. De plus, il a été démontré que même dans les cerveaux vieillissants, l’apprentissage de nouvelles compétences peut induire des changements fonctionnels et structuraux durables (Valenzuela & Sachdev, 2009).
2. Réduction de l’impact de la dépression sur le fonctionnement cognitif
La participation active à des exercices cognitifs aide à contrer le ralentissement mental et la perte d’initiative typiques des épisodes dépressifs, favorisant la motivation et la concentration (Bennett & Thomas, 2014). Ce type d’intervention peut atténuer les symptômes cognitifs secondaires à la dépression et améliorer les performances fonctionnelles quotidiennes.
3. Amélioration du bien-être émotionnel
La pratique régulière de la stimulation cognitive offre à la personne âgée l’opportunité de vivre des réussites personnelles, relever des défis et retrouver un sentiment de compétence. Ces facteurs renforcent l’estime de soi et réduisent le sentiment d’inutilité ou de désespoir, courants dans la dépression gériatrique (Cummings et al., 2019).
4. Prévention d’un déclin cognitif majeur
La dépression chez les personnes âgées est associée à un risque accru de trouble cognitif léger et de démence (Ownby et al., 2006). C’est pourquoi des interventions précoces comme la stimulation cognitive ne se contentent pas de traiter les symptômes actuels, mais peuvent contribuer à ralentir le déclin cognitif futur.
Conclusion
Au vu de ces constats, dans la seconde partie de cet article nous approfondirons les bénéfices spécifiques de la stimulation cognitive, des stratégies concrètes d’application clinique et le rôle de l’équipe interdisciplinaire et des aidants dans ce processus thérapeutique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la stimulation cognitive chez les personnes âgées souffrant de dépression, vous pouvez continuer à lire la deuxième partie de cet article ici.
Bibliographie
- Albala, C., et al. (2005). Envejecimiento y condiciones de salud en América Latina: resultados del estudio SABE. Organización Panamericana de la Salud.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Barnes, D. E., Alexopoulos, G. S., Lopez, O. L., Williamson, J. D., & Yaffe, K. (2006). Depressive symptoms, vascular disease, and mild cognitive impairment: findings from the Cardiovascular Health Study. Archives of General Psychiatry, 63(3), 273–279. https://doi.org/10.1001/archpsyc.63.3.273
- Blazer, D. G. (2003). Depression in late life: Review and commentary. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 58(3), 249–265. https://doi.org/10.1093/gerona/58.3.m249
- Cummings, J. L., Lyketsos, C. G., & Sweet, R. A. (2019). Cognitive and behavioral aspects of aging: A clinical guide. Oxford University Press.
- Draganski, B., & May, A. (2008). Training-induced structural changes in the adult human brain. Behavioural Brain Research, 192(1), 137–142. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2008.02.015
- González-Fernández, M., Moreno-Peral, P., Conejo-Cerón, S., Motrico, E., & Bellón, J. Á. (2020). Características clínicas y pronóstico de la depresión en el adulto mayor. Atención Primaria, 52(9), 598–607. https://doi.org/10.1016/j.aprim.2019.09.008
- Looi, J. C. L., & Macfarlane, M. D. (2009). Pseudodementia: Can depressive pseudodementia be distinguished from Alzheimer’s disease using specific clinical features? International Journal of Geriatric Psychiatry, 24(5), 469–475. https://doi.org/10.1002/gps.2142
- Park, D. C., & Bischof, G. N. (2013). The aging mind: Neuroplasticity in response to cognitive training. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15(1), 109–119. https://doi.org/10.31887/DCNS.2013.15.1/dpark
- Pérez-Arechaederra, D., et al. (2018). Depresión en personas mayores. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 53(2), 91–98. https://doi.org/10.1016/j.regg.2017.06.002
- Ritchie, K., Artero, S., & Touchon, J. (1994). Classification criteria for mild cognitive impairment: A population-based validation study. Neurology, 56(1), 37–42. https://doi.org/10.1212/WNL.56.1.37
- Valenzuela, M. J., & Sachdev, P. (2009). Can cognitive exercise prevent the onset of dementia? Systematic review of randomized clinical trials with longitudinal follow-up. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 17(3), 179–187. https://doi.org/10.1097/JGP.0b013e3181953b57
- Yesavage, J. A., et al. (1982). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17(1), 37–49. https://doi.org/10.1016/0022-3956(82)90033-4
Questions fréquentes sur l’effet placebo
1. Quelle est la relation entre la dépression et le déclin cognitif chez les personnes âgées ?
La dépression peut entraîner une atteinte des fonctions cognitives telles que la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives. Dans certains cas, ces symptômes sont confondus avec la démence, comme c’est le cas dans la pseudodémence dépressive.
2. Qu’est-ce que la pseudodémence dépressive ?
C’est un syndrome dans lequel les symptômes dépressifs simulent un trouble cognitif sévère, mais réversible avec un traitement approprié. Contrairement à la démence, il n’y a pas de progression neurodégénérative.
3. Pourquoi est-il difficile de diagnostiquer la dépression chez les personnes âgées ?
Les symptômes peuvent être atypiques : plaintes somatiques, apathie ou lenteur. De plus, elle a tendance à être confondue avec le vieillissement normal ou un trouble cognitif léger.
4. Comment diagnostique-t-on la dépression chez les personnes âgées ?
Avec des outils tels que la Geriatric Depression Scale (GDS), l’Inventaire de Beck adapté et des entretiens structurés comme le MINI.
5. Quels professionnels doivent intervenir en cas de dépression avec déclin cognitif ?
L’approche doit être multidisciplinaire et inclure des neuropsychologues, des psychologues cliniciens, des psychiatres, des ergothérapeutes et des médecins de soins primaires.
Si vous avez aimé cet article sur la dépression chez les personnes âgées, ces articles de NeuronUP pourraient vous intéresser :
« Cet article a été traduit. Lien vers l’article original en espagnol : »
La depresión en adultos mayores: impacto cognitivo y abordaje desde la estimulación



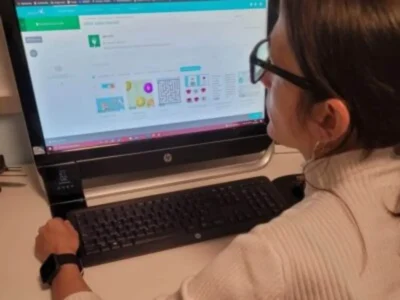





Laisser un commentaire