Le rééducateur Raúl A. Rosado Reyes présente dans cet article le rôle fondamental du soignant dans la réhabilitation des lésions cérébrales (LC), en soulignant son impact sur le processus de récupération et l’importance de son inclusion dans le plan de traitement.
Introduction
Le retour à domicile d’une personne atteinte d’une lésion cérébrale (LC) implique une adaptation pour toute la famille. Cette adaptation concerne aussi bien les aspects physiques, avec des modifications du domicile, que les aspects sociaux, économiques et récréatifs, entre autres. Au fur et à mesure de cette transition, les membres de la famille commencent à s’inquiéter des soins à prodiguer au patient, ce qui entraîne souvent anxiété et niveaux élevés de stress.
Pendant tout ce processus, la responsabilité est progressivement confiée au membre de la famille qui deviendra le soignant principal. En effet, dans la grande majorité des cas, le soignant principal est un membre de la famille (Gómez T. B, A. Herrera, F. Mayoral, 2000).
Le soignant est la personne qui assume la responsabilité de s’occuper d’une autre personne ayant une limitation ou un handicap l’empêchant de le faire seule. On entend souvent dire que les soignants sont des patients cachés en raison de la surcharge qu’ils subissent (Cocina N., 2014). Quero Ruflan, A., R. Briones Gómez, M. A. Prieto Rodríguez, A. Navarro López, N. Pascual Martínez, C. Guerrero, (SF) ont établi un profil des soignants, indiquant que 92 % étaient des femmes, 64 % étaient des femmes au foyer et 29 % des travailleuses. De même, ils ont constaté qu’après la sortie du patient, les soignants étaient dans 41,4 % des cas le conjoint et dans 28,3 % des cas le père ou la mère.
Le rôle du soignant dans la réhabilitation des lésions cérébrales (LC)
La lésion cérébrale (LC), étant une condition acquise, implique que la famille n’est jamais véritablement préparée à l’impact qu’elle provoque. Ainsi, la principale préoccupation de la famille est que le patient retrouve son état antérieur à l’accident.
Cependant, la réhabilitation physique et cognitive des cas de lésions cérébrales est individuelle. Il est nécessaire de prendre en compte de nombreux facteurs, tels que le type de traumatisme, le score sur l’échelle de coma de Glasgow (GCS), l’âge, le niveau d’éducation et le sexe, entre autres.
En plus de ces facteurs, il est essentiel de considérer qui est le soignant. Le soignant peut avoir un impact positif ou négatif sur la réhabilitation du patient. Un soignant qui s’informe sur la condition du patient et qui a des attentes réalistes en matière de réhabilitation pourra favoriser une acceptation plus réaliste de la situation et une meilleure adaptation au nouveau mode de vie.
L’impact d’un handicap sur le soignant souligne l’absence de programmes évaluant les expériences des personnes impliquées et la nécessité de comprendre comment les familles prenant soin des patients sont affectées. Les modèles de réhabilitation font appel à de nombreux professionnels dont l’objectif principal est d’optimiser le potentiel fonctionnel du patient. Ainsi, l’un des éléments clés d’un programme de réhabilitation doit être le soignant, qui veille quotidiennement à ce que le patient atteigne son niveau fonctionnel optimal et retrouve une certaine autonomie.
Pour promouvoir la réhabilitation d’une personne ayant subi une lésion cérébrale, il est essentiel de prendre en compte la nature et la gravité de la lésion, l’historique professionnel, les conditions émotionnelles préexistantes et divers facteurs démographiques.
En conséquence, l’adaptation à cette nouvelle réalité familiale peut entraîner une fatigue physique et émotionnelle chez le soignant. La qualité de vie des soignants familiaux se reconstruit au fil de l’expérience vécue.
Le fait que le soignant principal soit un membre de la famille entraîne un processus de deuil et de souffrance plus intense, ce qui peut affecter la réhabilitation physique et cognitive du patient. Afin de minimiser l’épuisement du soignant, il est essentiel de l’inclure dans le plan de traitement et les interventions menées auprès du patient.
Dans un modèle écologique de réhabilitation, il est fondamental de prendre en compte les expériences uniques et individuelles. Ce modèle intègre la perception, les connaissances, les expériences, les émotions, les habitudes et les traditions du patient et de sa famille. Il prend en considération le processus, le contexte, le temps et la personne (Céspede, 2005). C’est pourquoi le soignant doit être inclus dans la planification, le développement et l’adaptation du plan de traitement.
Le soutien émotionnel et pratique du soignant en cas de lésion cérébrale (LC)
Le soutien émotionnel et pratique des soignants de patients neurologiques est essentiel pour favoriser la réhabilitation de la personne atteinte. Le soignant s’efforce de fournir au patient ce dont il a besoin pour améliorer sa qualité de vie, tout en tenant compte des limites imposées par sa nouvelle réalité. Chaque individu définit la réhabilitation en fonction de ses éléments subjectifs, influencés par sa perception, son expérience, son éducation et son mode de vie. Lorsque la normalité est perdue, il est essentiel de comprendre l’expérience subjective du patient (Salas, 2008). Du fait du temps passé ensemble, le soignant et le patient partagent la joie de chaque progrès réalisé, mais aussi la frustration face aux tentatives infructueuses dans cette nouvelle réalité.
Impact émotionnel du soignant dans la réhabilitation des lésions cérébrales (LC)
L’impact émotionnel du soignant dans le traitement neurologique est influencé par les changements observés dans la personnalité du patient. Les soignants expriment souvent des sentiments tels que « il a changé », « c’est une autre personne », « je ne le reconnais plus », entre autres. L’idéal est que le soignant accepte la nouvelle réalité du patient. On peut observer plusieurs types de réactions chez les soignants :
- Ceux qui n’acceptent pas la nouvelle réalité du patient et lui imposent des exigences excessives ;
- ceux qui surprotègent le patient en l’empêchant de développer les compétences nécessaires à son indépendance ;
- et ceux qui prennent conscience de la réalité de la lésion et aident le patient à s’accepter lui-même.
Il est essentiel de prendre en compte les facteurs qui permettent de réduire l’épuisement émotionnel du soignant, afin d’éviter un désespoir lié à l’avenir du patient une fois qu’il sera seul.
Gómez, N. et al. (2021) identifient comme facteurs limitant l’accès à la réhabilitation des personnes atteintes de lésions cérébrales (LC) l’absence de soutien familial, les antécédents fonctionnels, l’âge et la capacité cognitive. Ainsi, une prise en charge multidisciplinaire intégrant des aspects biologiques, psychologiques et sociaux peut favoriser la réinsertion sociale du patient et réduire l’épuisement du soignant.
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
Le soignant comme partie intégrante du programme d’intervention pour les lésions cérébrales (LC)
Il est bien connu que le soignant néglige souvent sa propre santé, son travail, sa famille et d’autres aspects de sa vie. Cependant, lorsqu’il est intégré au programme d’intervention, il reçoit des informations essentielles à son bien-être. La surcharge du soignant est liée aux nouveaux rôles qui lui sont attribués, au stress, à l’épuisement émotionnel, aux changements dans sa routine quotidienne et aux implications économiques.
L’importance du soignant principal dans l’intervention pour les lésions cérébrales (LC)
D’après notre expérience, les soignants principaux se plaignent souvent de ne pas être inclus dans le plan de traitement. Cela les laisse dans l’ignorance quant à ce qu’ils doivent faire et comment le faire.
Le soignant est la source d’information la plus précieuse concernant les changements observés chez la personne atteinte d’une lésion cérébrale (LC) au cours de sa réhabilitation, car il passe le plus de temps avec elle.
L’intervention auprès des patients atteints de lésions cérébrales doit, une fois leur état stabilisé, inclure la prise en charge des aspects pharmacologiques, neuropsychologiques, physiques, occupationnels, du langage, cognitifs, sociaux et professionnels.
Nous pensons que ce modèle pourrait être enrichi par l’ajout d’aspects familiaux et spirituels, qui peuvent être bénéfiques pour la réhabilitation, l’adaptation et la réinsertion du patient. Domínguez-Roldán et al. (2005) suggèrent que les familles devraient être formées pour collaborer au programme de traitement.
Il est donc essentiel de mettre en place un modèle intégrant les éléments biologiques de la lésion, les réactions émotionnelles telles que la frustration, l’anxiété et la confusion, ainsi que les aspects psychologiques. Sensibiliser les soignants à ces enjeux leur sera bénéfique, tout comme au patient. Comprendre les objectifs du traitement permet de mieux fournir les informations nécessaires pour ajuster les objectifs de la réhabilitation.
Les bénéfices du soignant dans l’intervention pour les lésions cérébrales (LC)
Nous pouvons conclure que parmi les avantages qu’un soignant peut retirer de son inclusion dans le plan de traitement figurent une meilleure compréhension de l’impact du traumatisme et une acceptation plus réaliste des limitations fonctionnelles résiduelles.
Ces éléments sont essentiels, car ils permettent d’éviter d’imposer des exigences excessives au patient. Ainsi, le soignant peut l’aider à maintenir sa motivation pour participer activement à la réhabilitation et s’y engager durablement.
Conclusion
À la lumière de ces éléments, il est recommandé de mettre en place un groupe de soutien ou d’entraide destiné aux soignants, afin de réduire leur sentiment d’isolement, de leur permettre d’échanger leurs expériences, d’acquérir des connaissances sur la prise en charge des patients et de bénéficier d’un soutien émotionnel. Le développement de programmes d’accompagnement pour les soignants contribuera à leur adaptation et à la mise en place de stratégies de gestion adaptées.
Bibliographie
- Céspede, GM. (2005). La nouvelle culture du handicap et les modèles de réhabilitation. Revista Aquichan. Année 5, vol. 5, n° 1 (5), 108-113.
- Cocina, N. (2014). Patients cachés : les soignants des personnes atteintes de troubles cognitifs. Sociedad. http://www.telam.com.ar/notas
- Domínguez-Roldan, J.M, M. O Valle, C. G. García Alfaro et J, León Carrión. (2005) Traumatisme cérébral catastrophique : le patient critique. Revista Española de Neuropsicología, 7, 2-4, 187-221.


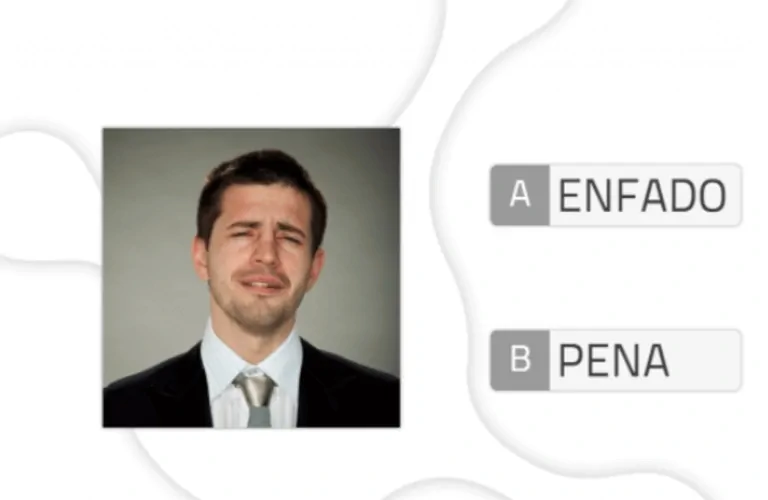
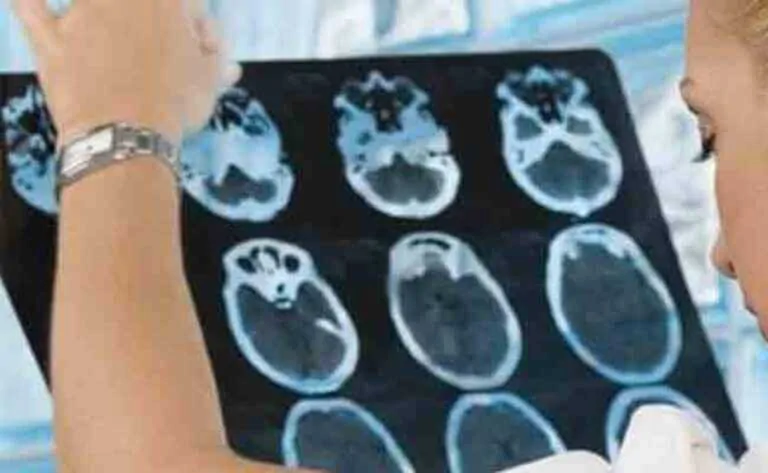

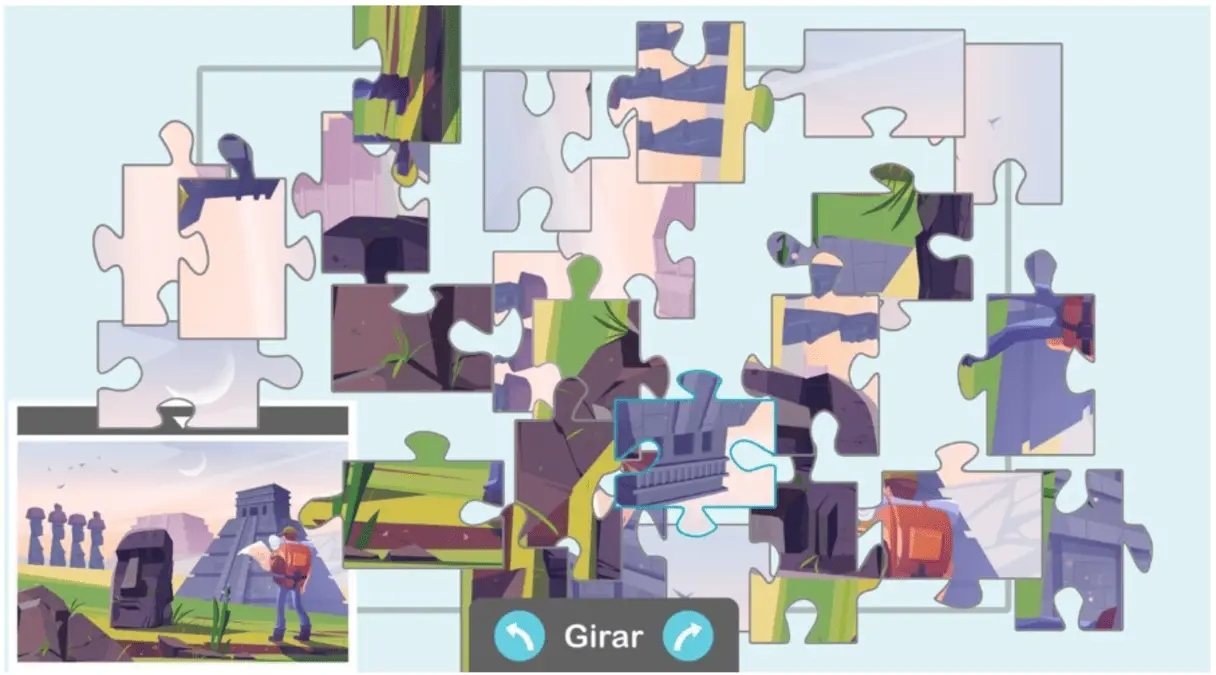
 Neuroscience du sommeil : comment le repos influence la récupération cérébrale et les performances cognitives
Neuroscience du sommeil : comment le repos influence la récupération cérébrale et les performances cognitives

Laisser un commentaire