Le docteur en psychologie Carlos Rebolleda explique les déficits de la théorie de l’esprit dans la schizophrénie et les tests pour son évaluation.
Le terme « théorie de l’esprit » fut initialement proposé par Premack et Woodruff (1978) et fait référence à la capacité de l’individu à inférer des états mentaux chez autrui tels que intentions, dispositions et croyances.
Évaluation de la théorie de l’esprit dans la schizophrénie
Ruiz, García et Fuentes (2006) soulignent que, généralement, les tests destinés à mesurer la théorie de l’esprit sont présentés sous forme de récits illustrés auxquels on soumet ensuite certaines questions. Ces questions ont pour objectif d’évaluer deux types de fausses croyances en lien avec l’histoire.
Types de questions
Questions de premier ordre
Les questions de premier ordre visent à évaluer dans quelle mesure le sujet évalué est capable de prédire le comportement d’un personnage guidé par une croyance erronée. Sally and Anne (Baron-Cohen, Leslie et Frith, 1985) et Cigarretes (Happè, 1994) sont des exemples d’histoires proposant des questions de premier ordre.
Questions de second ordre
Les questions de second ordre évaluent dans quelle mesure le sujet évalué est capable de prédire la fausse croyance qu’un personnage a sur celle d’un autre. Ice-Cream Van Store (Baron-Cohen, 1989) et Burglar Store (Happè et Frith, 1994) sont des tests conçus pour poser des questions de second ordre.
Hinting Task
Un des instruments les plus utilisés dans la recherche sur la psychose est le Hinting Task (Corcoran, Mercer et Frith, 1995) qui comprend dix courtes histoires dans lesquelles deux personnages interagissent. Toutes ces histoires se terminent par une allusion de l’un des personnages à l’autre. L’objectif de la tâche est que, après la lecture des différentes histoires par l’examinateur, le sujet tente d’expliquer ce que le personnage qui émet l’allusion essaie de dire.
Faux Pas Task
Le Faux Pas Task (Stone, Baron-Cohen, Calder et Keane, 1998) présente au sujet dix histoires dans lesquelles l’un des personnages commet une erreur en disant quelque chose de socialement embarrassant. Après avoir présenté chaque histoire au sujet, on lui demande de détecter la situation socialement embarrassante et d’évaluer ce que l’autre personnage a pu ressentir.
Le test exige du sujet la capacité de détecter des fausses croyances dans le cas de la personne qui commet l’erreur socialement embarrassante, et de déduire des états émotionnels selon ce qu’il estime que le personnage ayant reçu la verbalisation a pu ressentir.
Eye-Task
Eye-Task (Baron-Cohen, Wheelwright, Hill, Raste et Plumb, 2001) consiste à montrer aux participants plusieurs photographies ne montrant que les yeux d’une personne, en leur demandant d’inférer ce que la personne pourrait ressentir ou penser. Pour effectuer cette évaluation, le participant ne peut choisir qu’un seul des quatre mots qui lui sont proposés comme options.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Déficits de la théorie de l’esprit dans la schizophrénie
Les différences observées en termes de performance dans ce domaine entre patients diagnostiqués de schizophrénie et sujets témoins sont substantielles, comme le mettent en évidence deux métanalyses qui trouvent des tailles d’effet allant de moyennes (d=0,69) à grandes (d=1,25) pour ces différences (Bora, Yucel et Pantelis, 2009 ; Sprong, Schothorst, Vos, Hox et Van Engeland, 2007).
Hypothèses des recherches
Historiquement, on a cherché à étudier dans quelle mesure ce sont les symptômes de la schizophrénie qui déterminent les déficits que les personnes diagnostiquées avec cette maladie présentent en théorie de l’esprit.
Certaines recherches soutiennent l’hypothèse que le sujet doit présenter une théorie de l’esprit sans déficits d’aucune sorte pour pouvoir développer des idées délirantes de persécution (Drury, Robinson et Birchwood, 1998 ; Watson, Blenner-Hassett et Charlton, 2000).
D’autres indiquent que les patients présentant une symptomatologie négative ou désorganisée n’ont jamais développé de théorie de l’esprit, ce qui peut se constater dans leur performance moindre lorsqu’ils sont confrontés à des tâches exigeant l’utilisation de cette capacité (Garety et Freeman, 1999 ; Greig, Bryson et Bell, 2004).
Objectif des recherches
Un objectif actuel dans l’étude des déficits en théorie de l’esprit dans la schizophrénie est d’identifier si ces déficits ressemblent à un trait ou à un état de la maladie, car cela aiderait à résoudre la question de savoir s’ils sont exclusivement associés aux symptômes de la maladie.
Il est à noter que l’essentiel des recherches menées à cet égard indique que ces déficits constitueraient un trait intrinsèque de la maladie (Herold, Tenyi, Lenard et Trixler, 2002 ; Irani et al., 2006 ; Janssen, Krabbendam, Jolles et Van Os, 2003 ; Penn, Sanna et Roberts, 2008).
Cependant, des études comme celle de Bora et al. (2009) montrent que, bien que ces déficits semblent rester présents à n’importe quelle phase de la maladie, on ne sait pas dans quelle mesure ce seraient les problématiques neurocognitives en mémoire de travail et fonctions exécutives, ou la symptomatologie résiduelle elle-même, les facteurs qui contribuent réellement au maintien de ces déficits.
Il semble donc nécessaire de poursuivre les recherches dans cette direction avant de pouvoir affirmer que ces déficits constituent un trait de la maladie.
Vision neurologique
Au niveau neurologique, Rodríguez et Touriño (2010) soulignent que, dans des études de neuroimagerie chez des sujets sains, il a été constaté que certaines zones cérébrales comme le cortex préfrontal, l’amygdale ou le lobe pariétal inférieur s’activent lors de la réalisation de tâches mettant en œuvre la théorie de l’esprit (Brunet, Sarfati, Hardy-Bayle et Decety, 2000 ; 2003). Dans le cas des patients diagnostiqués de schizophrénie, on a observé une diminution de l’activation du cortex préfrontal droit et du gyrus frontal inférieur gauche lors de l’exécution de tâches de ce type (Adolphs, 2002 ; Brunet et al., 2000).
Bibliographie
- Adolphs, R. (2002). Neural systems for recognizing emotion. Current Opinion in Neurobiology, 12(2), 1-9
- Baron- Cohen, S. (1989). The autistic child´s theory of mind: a case of specific developmental delay. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 30(2), 285-297
- Baron- Cohen, S., Leslie, A. M., y Frith, U. (1985). Does the autistic child have a theory of mind? Cognition, 21(1), 37-46
- Baron‐Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., y Plumb, I. (2001). The “Reading the mind in the eyes” test revised version: a study with normal adults, and adults with asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(2), 241-251.
- Bora, E., Yucel, M., y Pantelis, C. (2009). Theory of mind impairment in schizophrenia: meta- analysis. Schizophrenia Research, 109 (1-3), 1-9
- Brunet, E., Sarfati, Y., Hardy-Bayle, M. C., y Decety, J. (2000). PET investigation of the attribution of intentions with nonverbal task. Neuroimage, 11(2), 157-166
- Brunet, E., Sarfati, Y., Hardy-Bayle, M. C. y Decety, J. (2003). Abnormalities of brain function during a nonverbal theory of mind task in schizophrenia. Neuropsychologia, 41(12), 1574-1582.
- Corcoran, R., Mercer, G., y Frith, C. D. (1995). Schizophrenia, symptomatology and social inference: investigating “theory of mind” in people with schizophrenia. Schizophrenia Research, 17(1), 5-13.
- Drury, V. M., Robinson, E. J., y Birchwood, M. (1998). Theory of mind skills during an acute episode of psychosis and following recovery. Psychological Medicine, 28(5), 1101-1112
- Garety, P. A., y Freeman, D. (1999). Cognitive approaches to delusions: a critical review of theories and evidence. British Journal of Clinical Psychology, 38(2), 113-154.
- Greig, T. C., Bryson, G. J., y Bell, M. D. (2004). Theory of mind performance in schizophrenia: diagnostic, symptom and neuropsychological correlates. Journal of Nervous and Mental Disease, 192(1), 12-18
- Happè, F. (1994). An advanced test of theory of mind: understanding of story characters thoughts and feelings by able autistics, mentally handicapped and normal children and adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24(2), 129-154
- Happè, F., y Frith, U. (1994). Theory of mind in autism. En E.Schloper y G.Mesivob (Eds). Learning and Cognition in Autism (pp.177-197). NuevaYork, NY: Plenum Press
- Herold, R., Tenyi, T., Lenard, K., y Trixler, M. (2002). Theory of mind deficit in people with schizophrenia during remission. Psychological Medicine, 32(6), 1125-1129
- Irani, F., Platek, S. M., Panyavin, I. S., Calkins, M. E., Kohler, C., Siegel, S. J.,… y Gur, R. C. (2006). Self-face recognition and theory of mind in patients with schizophrenia and first-degree relatives. Schizophrenia Research, 88(1-3), 151-160.
- Janssen, I., Krabbendam, L., Jolles, J., y Van Os, J. (2003). Alterations in theory of mind in patients with schizophrenia and non-psychotic relatives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108(2), 110-117
- Penn, D. L., Sanna, L. J., y Roberts, D. L. (2008). Social Cognition in schizophrenia: an overview. Schizophrenia Bulletin, 34(3), 408-411
- Premack, D., y Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1(4), 515-526.
- Rodríguez, J. A., y Touriño, R. (2010). Cognición social en la esquizofrenia: una revisión del concepto. Archivos de Psiquiatría, 73, 9-12
- Ruiz, J. C., García, S., y Fuentes, I. (2006). La relevancia de la cognición social en la esquizofrenia. Apuntes de Psicología, 24(1-3), 137-155
- Sprong, M., Schothorst, P., Vos, E., Hox, J., y Van Engeland, H. (2007). Theory of mind in schizophrenia: meta- analysis. British Journal of Psychiatry, 191(1), 5-13.
- Stone, V. E., Baron-Cohen, S., Calder, A. W., y Keane, J. (1998). Impairments in social cognition following orbitofrontal or amygdale damage. Society for Neuroscience Abstracts, 24, 1176
- Watson, F., Blenner-Hasset, R. C., y Charlton, B. G. (2000). Theory of mind, persecutory delusions and the somatic marker mechanism. Cognitive Neuropsychiatry, 5(3), 161-174.
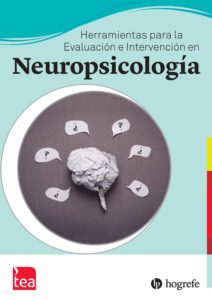

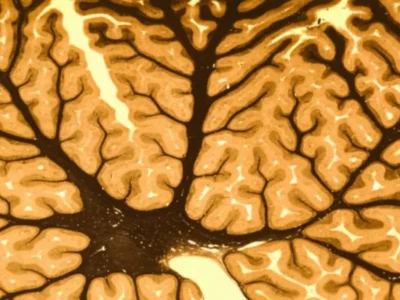




 Guide pour la revue de la littérature sur les apraxies
Guide pour la revue de la littérature sur les apraxies

Laisser un commentaire