Martha Valeria Medina Rivera, neuropsychologue de NeuronUP, nous explique comment la diaschisis influence les séquelles cognitives après un TCE et le rôle clé de la neuropsychologie dans sa réhabilitation.
Introducción
Le traumatisme crânio-encéphalique (TCE) est l’une des principales causes d’invalidité et de mortalité dans le monde. Parmi ses origines les plus fréquentes figurent les chutes et les accidents de la route, ces derniers ayant un poids beaucoup plus important dans les pays à faibles et moyens revenus, où ils représentent jusqu’à 56 % des cas, contre 25 % dans les pays à hauts revenus, la réglementation routière de chaque pays déterminant leur incidence. À l’échelle mondiale, on estime qu’il survient environ 69 millions de TCE chaque année, avec une charge trois fois plus élevée dans les pays à faibles ressources (Halalmeh et al., 2024).
Ce constat reflète la complexité du TCE, en particulier dans les accidents de la route, où les lésions ne provoquent pas seulement des dommages focaux, mais aussi des déconnexions fonctionnelles à distance. C’est ici que le concept de diaschisis prend tout son sens, essentiel pour comprendre pourquoi de nombreuses altérations cognitives ne dépendent pas uniquement de la zone lésée, mais de la déconnexion de réseaux cérébraux plus larges.
Par conséquent, l’objectif de cet article est d’analyser la relation entre le TCE provoqué par des accidents de la route et le phénomène de diaschisis, ainsi que le rôle de la neuropsychologie en tant que composante clé pour optimiser les stratégies d’intervention et améliorer le pronostic fonctionnel des personnes affectées.
Traumatismo craneoencefálico (TCE)
Le TCE se conçoit comme une lésion structurelle ou une perturbation physiologique de la fonction cérébrale provoquée par une force externe (Mckee & Daneshvar, 2015).
Selon le guide clinique du Département des Anciens Combattants et du Département de la Défense des États-Unis (VA/DoD, 2009 dans Mckee & Daneshvar, 2015), le diagnostic est posé
La sévérité du TCE se classe principalement avec l’échelle de coma de Glasgow (GCS), la durée de la perte de conscience (LOC) et de l’amnésie post-traumatique (PTA) :
- Léger : GCS 13–15, LOC < 1 h, PTA < 24 h.
- Modéré : GCS 9–13, LOC 1–24 h, PTA 1–7 jours.
- Sévère : GCS 3–8, LOC > 24 h, PTA > 1 semaine.
Bien que la majorité des cas (75–85 %) soient légers, entre 15 et 30 % des personnes développent des symptômes persistants qui affectent la cognition, le comportement et l’état émotionnel, ce qui montre que même les formes les plus légères peuvent avoir des conséquences à long terme (Mckee & Daneshvar, 2015).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Conexión entre alteraciones cognitivas y el daño cerebral específico post-TCE
Los cambios cognitivos y conductuales tras un TCE son frecuentes y afectan de forma significativamente la vida diaria del individuo (Mckee & Daneshvar, 2015; Halalmeh et al., 2024). Para comprender esta complejidad, es necesario describir los mecanismos de lesión y los procesos neurofisiológicos que subyacen al TCE, especialmente en el contexto de accidentes automovilísticos (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024).
Durante un choque, el cerebro está expuesto a fuerzas de aceleración-desaceleración, impactos directos y movimientos de rotación (Azouvi et al., 2017). Estos mecanismos provocan dos tipos principales de daño:
- Lesiones focales: inflamación, contusiones, hematomas o hemorragias internas, que afectan principalmente las regiones frontales y temporales (Mckee & Daneshvar, 2015).
- Lesiones difusas: comprometen la sustancia blanca, en especial el cuerpo calloso y tractos de conexión frontoestriatales y temporoparietales, desorganizando redes neuronales a gran escala (Mckee & Daneshvar).
A esto se añade una cascada de procesos secundarios que intensifican los cambios cerebrales: excitotoxicidad por exceso de glutamato, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, reducción del flujo sanguíneo cerebral, edema, desequilibrio de neurotransmisores y neuroinflamación mediada por microglía (con efectos tanto dañinos como reparadores) (Mckee & Daneshvar, 2015).
Las lesiones focales, difusas y procesos secundarios constituyen la base neurobiológica de las dificultades cognitivas y conductuales observadas tras el TCE. Las secuelas cognitivas más habituales suelen estar asociadas a las áreas afectadas por la lesión e incluyen dificultades (Halalmeh et al., 2024).
Diasquisis y su relación con el TCE
Como hemos visto, el TCE puede dañar regiones cerebrales implicadas en determinadas funciones cognitivas; sin embargo, hoy sabemos que no existe un localizacionismo estricto que asocie de manera única una función a una zona. El cerebro funciona como una red interconectada y, en muchas ocasiones, se observan alteraciones en procesos cognitivos incluso cuando la lesión no se encuentra en la región usualmente relacionada a esas funciones.
Ce phénomène, décrit par von Monakow en 1914 comme la diaschisis, consiste en une diminution de l’excitabilité neuronale dans des zones éloignées de la lésion en raison de l’interruption des voies de connexion (Carrera & Tononi, 2014).
La diaschisis fonctionne comme une stratégie défensive : après la lésion, de vastes régions entrent dans un état d’hypo‑excitabilité ou de « phase de choc » qui peut se rétablir progressivement selon l’étendue des dommages et la plasticité cérébrale. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes présentent des changements moteurs, sensoriels ou cognitifs qui ne correspondent pas à la zone anatomique lésée, car il peut impliquer non seulement le cortex, mais aussi des structures profondes comme le thalamus et le cervelet, fondamentales pour l’organisation motrice et cognitive (Sarmati, 2022).
Dans des modèles animaux, on a également décrit une diaschisis transhémisphérique aiguë, caractérisée par une hyperactivité controlatérale transitoire dans les premières 24–48 heures, ce qui ouvre la possibilité d’interventions précoces pour moduler la plasticité neuronale (Le Prieult et al., 2017).
Plus récemment, il a été proposé que la diaschisis inclue aussi des adaptations métaboliques. Boggs et al. (2024) décrivent un schéma de diaschisis métabolique focale dans lequel des régions controlatérales à la lésion montrent des changements biochimiques semblant orientés vers l’amélioration de la fonction mitochondriale, la réduction du stress oxydatif, la préservation de l’intégrité neuronale et la prévention de la dégénérescence gliale. Cette découverte souligne que la diaschisis peut également agir comme un mécanisme protecteur, modulant le métabolisme énergétique pour compenser la dysfonction produite par la lésion initiale du TCE.
Il est important de différencier le phénomène de diaschisis des lésions distales telles que l’atteinte axonale diffuse, qui est produite par des forces de tension endommageant directement les membranes axonales (Azouvi et al., 2017; Le Prieult et al., 2017; Halalmeh et al., 2024), puisque dans la diaschisis l’approche est principalement une déconnexion fonctionnelle et non une rupture en tant que telle (Le Prieult et al., 2017).
Par conséquent, comprendre la diaschisis est essentiel pour expliquer pourquoi les difficultés cognitives et émotionnelles après un TCE ne dépendent pas uniquement de la lésion primaire, mais d’un effet en réseau qui altère l’efficacité globale du cerveau. D’un point de vue clinique, elle peut durer des semaines, des mois ou même toute la vie, ce qui souligne l’importance d’orienter la réorganisation cérébrale avec des interventions neurocognitives appropriées et respectueuses des rythmes du système nerveux (Sarmati, 2022).
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
Dificultades cognitivas tras un TCE y el papel de la diasquisis
Las consecuencias cognitivas y conductuales de un traumatismo craneoencefálico (TCE) son variadas y dependen tanto del daño directo, como de procesos secundarios que afectan la dinámica de redes cerebrales. Entre estos, la diaschisis es especialmente relevante, ya que explica cómo funciones alejadas de la zona lesionada pueden implicarse debido a la desconexión funcional de circuitos interrelacionados (Carrera & Tononi, 2014).
Dificultades de memoria tras un TCE
Las dificultades de memoria son de las más persistentes tras un TCE. La memoria episódica se caracteriza por un aprendizaje más lento, un olvido acelerado y mayor vulnerabilidad a la interferencia; igualmente, la memoria prospectiva y autobiográfica también muestran dificultades significativas (Halalmeh et al., 2024). Estos cambios no solo reflejan el daño directo en regiones frontotemporales, sino que también pueden ser producto de la desconexión entre el hipocampo y las áreas prefrontales generado por la diaschisis, lo que compromete la codificación y recuperación eficiente de la información.
Dificultades de atención y velocidad de procesamiento tras un TCE
Las personas con TCE suelen presentar dificultades en la atención sostenida, dividida y selectiva, a menudo acompañadas de fatiga mental. Aunque esto, generalmente, se asocia al daño axonal difuso, también puede ser explicado por la hipoexcitabilidad de redes frontoparietales vinculada a la diaschisis, que limita la capacidad de distribuir recursos atencionales de manera eficaz (Le Prieult et al., 2017). En paralelo, la velocidad de procesamiento se encuentra enlentecida incluso en tareas simples, no solo por la afectación estructural de la sustancia blanca, sino también por la interrupción de la conectividad interhemisférica (Azouvi et al., 2017).
Dificultades en las funciones ejecutivas tras un TCE
Las funciones ejecutivas también se ven comprometidas tras un TCE. Aunque el daño frontal directo constituye un factor claro, la diaschisis permite entender por qué incluso lesiones en áreas temporales o subcorticales generan alteraciones ejecutivas: al interrumpirse la comunicación con las redes prefrontales, aumenta la dificultad en la autorregulación y en la capacidad de adaptación funcional (Halalmeh et al., 2024).
Por último, después de un TCE, la cognición social y la conducta también pueden presentar dificultades en el reconocimiento de emociones y en la interpretación de claves sociales, lo que impacta directamente en las relaciones interpersonales.
Además, pueden presentarse cambios conductuales como desinhibición, impulsividad e irritabilidad, y la apatía o falta de iniciativa, afectando la reintegración familiar, social y laboral (Azouvi et al., 2017). Aquí la diaschisis desempeña un papel explicativo al mostrar cómo alteraciones en redes distribuidas —más allá de la lesión focal— influyen en procesos sociales y emocionales complejos.
La importancia de la neuropsicología en el manejo del TCE
Dada la complejidad de los cambios estructurales y funcionales que ya se han mencionado, muchas veces moduladas por la diaschisis, la neuropsicología juega un papel central tanto en la evaluación como en la intervención. Halalmeh et al. (2024) destacan la relevancia de la neuropsicología de intervención para prevenir la progresión hacia un síndrome postconmocional (PCS) y otros cambios persistentes. Incluso en los TCE leves, algunas personas desarrollan síntomas duraderos como cefaleas, problemas de memoria o alteraciones emocionales.
Las intervenciones psicoeducativas tempranas han mostrado eficacia para reducir la cronificación de síntomas, modificar expectativas negativas y orientar la reincorporación progresiva a las actividades. A su vez, los programas de rehabilitación cognitiva permiten entrenar funciones como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas con estrategias personalizadas. Estas se complementan con psicoterapia, en particular la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a manejar los síntomas emocionales y conductuales asociados al TCE.
Este enfoque integral no solo mejora el pronóstico funcional, sino que también optimiza el uso de recursos sanitarios, reduciendo la necesidad de intervenciones más invasivas en fases posteriores.
Conclusión
Le TCE dans les accidents de la route est un événement neurologique complexe dont les conséquences vont bien au-delà du dommage focal visible. Intégrer le concept de diaschisis permet de mieux comprendre pourquoi les difficultés cognitives et comportementales ne correspondent pas toujours directement à la zone lésée, mais reflètent l’altération de réseaux cérébraux interconnectés.
Ce phénomène, qui inclut non seulement des processus d’inhibition fonctionnelle mais aussi des adaptations métaboliques, montre que le cerveau répond à la lésion par des mécanismes à la fois de vulnérabilité et de compensation. Ainsi, des fonctions telles que la mémoire, l’attention, la vitesse de traitement ou les fonctions exécutives peuvent être compromises, même lorsqu’il n’existe pas de lésion directe dans les zones traditionnellement associées à celles-ci.
Dans l’ensemble, l’étude du TCE et de la diaschisis nous rappelle que le cerveau fonctionne comme un système en réseau. Reconnaître cette perspective est essentiel pour progresser vers des modèles explicatifs plus réalistes de l’impact global de ces lésions.
Par conséquent, un modèle interdisciplinaire où neuropsychologie, neurologie, kinésithérapie et ergothérapie travaillent conjointement devient indispensable. À cet égard, il est important de souligner que la neuropsychologie a un rôle essentiel dans l’évaluation et l’intervention après un TCE, car elle permet d’identifier précisément les fonctions affectées et de comprendre comment elles interagissent avec les phénomènes de déconnexion cérébrale ; ainsi on obtient non seulement le profil cognitif de chaque personne, mais on pose aussi les bases pour concevoir des stratégies d’approche individualisées et fondées.
Bibliografía
- Azouvi, P., Arnould, A., Dromer, E., & Vallat-Azouvi, C. (2017). Neuropsychology of traumatic brain injury: An expert overview. Revue Neurologique, 173(7), 461–472. https://doi.org/10.1016/j.neurol.2017.07.006
- Boggs, R. C., Watts, L. T., Fox, P. T., & Clarke, G. D. (2024). Metabolic diaschisis in mild traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 41(13–14), e1793–e1806. https://doi.org/10.1089/neu.2023.0290
- Carrera, E., & Tononi, G. (2014). Diaschisis: Past, present, future. Brain, 137(9), 2408–2422. https://doi.org/10.1093/brain/awu101
- Halalmeh, D. R., Salama, H. Z., LeUnes, E., Feitosa, D., Ansari, Y., Sachwani-Daswani, G. R., & Moisi, M. D. (2024). The role of neuropsychology in traumatic brain injury: Comprehensive literature review. World Neurosurgery, 183, 128–143. https://doi.org/10.1016/j.wneu.2023.12.069
- Le Prieult, F., Thal, S. C., Engelhard, K., Imbrosci, B., & Mittmann, T. (2017). Acute cortical transhemispheric diaschisis after unilateral traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 34(5), 1097–1110. https://doi.org/10.1089/neu.2016.4575
- Mckee, A. C., & Daneshvar, D. H. (2015). The neuropathology of traumatic brain injury. Handbook of Clinical Neurology, 127, 45–66. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-52892-6.00004-0
- Sarmati, V. (2022.). Diasquisis. Stroke Therapy Revolution. Consulté le 25 août 2025, de https://www.stroke-therapy-revolution.es/diasquisis/
- Wiley, C. A., Bissel, S. J., Lesniak, A., Dixon, C. E., Franks, J., Beer Stolz, D., Sun, M., Wang, G., Switzer, R., Kochanek, P. M., & Murdoch, G. (2016). Ultrastructure of diaschisis lesions after traumatic brain injury. Journal of Neurotrauma, 33(20), 1866–1882. https://doi.org/10.1089/neu.2015.4272
Preguntas frecuentes sobre el TCE y la diasquisis
1. Qu’est-ce que le traumatisme crânio-encéphalique (TCE) ?
Un traumatisme crânio-encéphalique est une lésion du cerveau causée par une force externe, comme un coup, une secousse ou un impact direct à la tête. Il peut être léger, modéré ou sévère selon le niveau de conscience, la durée de l’amnésie et la présence d’une atteinte structurelle.
2. Qu’est-ce que la diaschisis et comment est-elle liée au TCE ?
La diaschisis est un phénomène dans lequel des zones cérébrales éloignées de la lésion primaire réduisent leur activité en raison de la déconnexion fonctionnelle des réseaux neuronaux. Dans un TCE, cela explique pourquoi des déficits cognitifs peuvent apparaître dans des régions non directement lésées.
3. Quelles sont les séquelles cognitives les plus courantes après un TCE ?
Parmi les plus fréquentes figurent des altérations de la mémoire, de l’attention, de la vitesse de traitement, des fonctions exécutives et de la cognition sociale. Celles‑ci peuvent affecter durablement la vie quotidienne et la réintégration sociale et professionnelle de la personne.
4. Pourquoi la neuropsychologie est-elle importante dans la prise en charge du TCE ?
La neuropsychologie évalue l’impact cognitif et émotionnel du TCE et met en œuvre des programmes personnalisés de réhabilitation cognitive, psychoéducation et thérapie comportementale pour favoriser la récupération fonctionnelle et prévenir les séquelles chroniques.
5. Quelles techniques de stimulation cognitive sont utilisées en rééducation post-TCE ?
Des programmes d’entraînement cognitif centrés sur la mémoire, l’attention et les fonctions exécutives, adaptés aux besoins de la personne, sont utilisés, combinés à la psychothérapie, à des techniques compensatoires et à un soutien interdisciplinaire (kinésithérapie et ergothérapie).
Si vous avez aimé cet article sur le traumatisme crânio-encéphalique par accident de la route et la diaschisis : impact neuropsychologique, ces articles de NeuronUP pourraient sûrement vous intéresser :
« Cet article a été traduit. Lien vers l’article original en espagnol : »
Traumatismo craneoencefálico por accidente automovilístico y diasquisis: impacto neuropsicológico

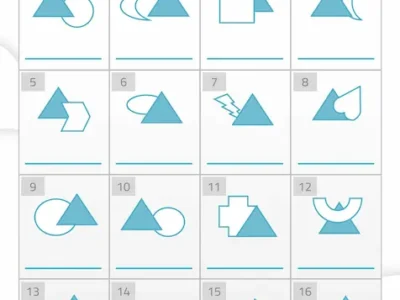







Laisser un commentaire