Marcos Ríos-Lago expose la complexité de l’évaluation de la prise de décision en neuropsychologie clinique, en analysant sa base cérébrale et les instruments les plus utilisés pour son évaluation.
Évaluation neuropsychologique et fonctions exécutives
Nous, neuropsychologues, devons aborder, dans le cadre de notre travail quotidien, l’évaluation de l’attention, de la mémoire et d’autres processus cognitifs. Parmi tous les mécanismes, on peut souligner la complexité de l’évaluation des fonctions exécutives. Il s’agit d’un construit complexe (peut-être la réunion de plusieurs construits sous un même parapluie conceptuel) pour lequel nous ne disposons pas d’un modèle cognitif accepté par l’ensemble de la communauté scientifique.
Modèles actuels pour l’étude des fonctions exécutives
Il existe certains modèles tels que celui de Mateer (1999), d’une grande utilité clinique, ou celui de Diamond (2013), qui trouve un bon équilibre entre la réalité du fonctionnement du système nerveux et le pragmatisme nécessaire au quotidien en neuropsychologie clinique. Cependant, aucun d’entre eux, bien qu’excellents outils, ne décrit en détail une activité quotidienne comme la prise de décision, que beaucoup d’entre nous considéreraient comme relevant de cet ensemble de fonctions exécutives.
Propositions théoriques récentes
Il existe quelques propositions théoriques, comme celles rapportées par Morelli et al. (2022) ou Lebreton et Lopez-Persem (2022), illustrant encore davantage la complexité extrême d’un processus de prise de décision.
Qu’est-ce que la prise de décision d’un point de vue neuropsychologique ?
La prise de décision est une fonction qui intègre des processus cognitifs, affectifs et motivationnels. Il s’agit d’une fonction complexe visant à sélectionner une option ou une action parmi plusieurs alternatives et à choisir la plus adaptative pour atteindre un objectif, en se basant sur les capacités/compétences de l’individu, ses émotions, ses valeurs, ses préférences et ses croyances, et elle est influencée par des facteurs contextuels, motivationnels et sociaux.
Ce processus se termine généralement par un choix, qui peut ou non être mis en œuvre. De plus, il peut s’appliquer à des éléments concrets (comme choisir quoi manger ou quelle rue emprunter) ou abstraits (comme choisir quoi croire, abandonner ou non un poste, investir dans le bitcoin, etc.).
Types de décisions et facteurs impliqués dans la prise de décision
Selon Glimcher (2013), il existe des décisions de type perceptif, des décisions basées sur la valeur ou des décisions générales.
Cependant, les éléments impliqués sont multiples, complexes et dont nous ignorons l’interaction :
- niveaux d’abstraction ou de tangibilité de la décision,
- impact de la décision (à court et à long terme),
- automatisme dans le processus (vs contrôle),
- analyse des gains et des pertes,
- calculs de probabilités,
- gestion de l’incertitude,
- éléments émotionnels impliqués,
- ainsi que le contexte physique et social.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Importance clinique de l’évaluation de la prise de décision en neuropsychologie
D’un point de vue neuropsychologique, l’étude de la prise de décision est cruciale pour comprendre comment certaines altérations du fonctionnement cérébral peuvent affecter la capacité d’une personne à choisir de manière adaptative, ce qui a des répercussions directes sur la vie quotidienne, l’autonomie et la qualité de vie.
Modèles théoriques utiles pour guider l’évaluation de la prise de décision
Comme toujours, disposer de modèles qui guident l’évaluation et nous aident à interpréter les résultats est fondamental.
Certains intègrent les phases suivantes (Ernst, 2005 ; Doya, 2008 ; Robinson, 2016 ; Heilbronner et Hayden, 2016) :
- Présentation de plusieurs stimuli prédisant des résultats mesurables.
- Évaluation des options et formation de préférences.
- Sélection des options.
- Sélection des actions et exécution.
- Évaluation des actions et des résultats.
De plus, nous connaissons le coût élevé d’une analyse froide et exhaustive des informations disponibles (si nous sommes honnêtes, il faut reconnaître son impossibilité) pour ensuite calculer la meilleure option possible.
La perspective évolutionniste indique qu’en raison de cette complexité incommensurable à appréhender par un raisonnement froid, nous disposons d’un système qui applique des heuristiques. Autrement dit, nous mobilisons tout notre bagage d’apprentissages pour les décisions présentes (Van der Pligt, 2015 ; Lerner et al., 2015 ; Damasio, 1996 ; Bechara et al., 1994).
Structures cérébrales impliquées dans les processus de prise de décision
Malgré sa complexité, certaines structures sont aujourd’hui connues pour être impliquées dans ces processus, résumées dans le Tableau 1.
| Structure cérébrale | Fonction principale |
| Cortex préfrontal dorsolatéral | Planification, raisonnement, régulation émotionnelle |
| Cortex orbitofrontal | Représentation des récompenses et des probabilités, flexibilité adaptative |
| Cortex ventromédial | Codage de la valeur subjective |
| Cingulaire antérieur | Supervision, évaluation de l’effort, détection d’erreurs |
| Insula | Évaluation des états internes, anticipation émotionnelle |
| Amygdale | Évaluation de la pertinence |
| Striatum | Prédiction de récompense, apprentissage par renforcement |
| Cortex pariétal | Calcul probabiliste et spatial des options |
Altérations cliniques de la prise de décision
Les lésions de ces structures, ou leur dégénérescence liée à des maladies, provoquent généralement des déficits dans chacun des éléments constituant la prise de décision. Leur étude en neuropsychologie permet de comprendre les altérations associées à diverses pathologies neurologiques et psychiatriques.
En résumé, quelques-unes des principales caractéristiques observables dans différents groupes cliniques sont esquissées (Tableau 2). Les erreurs les plus fréquentes poussent les individus à donner des réponses désadaptatives, différentes de celles observées chez la population saine.
| Trouble | Altération de la prise de décision |
| TCC | Impulsivité, désinhibition, risque élevé |
| Démence frontotemporale | Dérégulation sociale, apathie, choix rigides |
| Maladie d’Alzheimer | Perte de jugement, évaluation déficiente des conséquences |
| TDAH | Décisions précipitées, faible contrôle inhibiteur |
| Trouble bipolaire | Comportements à risque en phase maniaque, indécision en phase dépressive |
| Schizophrénie | Déficits de motivation, attribution de valeur et apprentissage par feedback |
| Dépression et anxiété | Biais négatif, évitement, surestimation du risque, rumination et indécision, déficit dans la recherche de renforcement, altérations de l’évaluation du coût |
| Apathie | Absence de préférence entre les options, valeur diluée des options, manque d’exécution |
| Addictions | Surostimulation de la récompense immédiate |
Instruments disponibles pour l’évaluation de la prise de décision
En ce qui concerne les instruments disponibles pour son évaluation, il n’existe pas de méthode unique acceptée par l’ensemble de la communauté scientifique. Il n’existe pas non plus de directives cliniques pour l’enregistrement adéquat de ce processus et les critères existants sont variables et peu consensuels.
Dans tous les cas, il est nécessaire d’intégrer certains aspects éthiques (qui compliquent encore davantage la tâche d’évaluation), tels que trouver un équilibre entre le respect de la liberté de l’individu et sa sécurité, être compétent pour évaluer la prise de décision, et savoir sélectionner, appliquer et interpréter correctement les outils et les résultats obtenus.
L’évaluation, comme dans la plupart des situations en neuropsychologie, doit être en mesure de répondre à une question spécifique. Celle-ci peut viser à établir un diagnostic, à détecter une difficulté en vue d’une éventuelle indemnisation, à concevoir un plan de réhabilitation ou, même, à répondre à une question précise dans un contexte médico-légal (capacité parentale, gestion de ses finances personnelles, responsabilité pénale, capacité à tester, etc.).
Voyons quelques exemples :
- Diagnostic différentiel : certains troubles présentent des profils spécifiques d’altération de la prise de décision (par exemple, le jeu pathologique, la démence frontotemporale, le TDAH ou la schizophrénie).
- Évaluation de l’autonomie fonctionnelle : particulièrement pertinente chez les personnes âgées, celles présentant un déficit cognitif ou des lésions cérébrales, car des décisions inappropriées peuvent affecter leur capacité à gérer leurs finances, à signer des documents légaux ou à vivre de façon indépendante.
- Planification d’interventions : une évaluation précise permet de concevoir des stratégies de réhabilitation ou de soutien qui améliorent la capacité de choix ou compensent les déficits.
Selon Freedman, Stuss et Gordon (1991), l’évaluation des processus cognitifs sous-jacents à la capacité de prendre des décisions compétentes est nécessaire, en mettant l’accent sur l’identification des fonctions préservées pouvant compenser les déficits existants.
Il s’agit donc d’évaluer les performances de l’attention, du langage, de la mémoire et des fonctions exécutives. Le patient doit avoir une attention suffisante pour participer à l’évaluation des fonctions cognitives spécifiques. Il convient de vérifier si le patient comprend les instructions pertinentes, retient l’information assez longtemps pour l’évaluer par rapport à des expériences récentes et passées, et exprime ses souhaits.
Ensuite, il faut déterminer si le patient possède un jugement suffisamment intact et un niveau de conscience adéquat de ses performances et de ses difficultés. Les cliniciens doivent également connaître les éléments exécutifs susceptibles d’influencer le processus de prise de décision.
Par exemple, l’inhibition des réponses impulsives, la capacité de planifier et de séquencer les actions, la flexibilité pour s’adapter à de nouvelles contingences, et la capacité de superviser les performances, de détecter et de corriger les erreurs. L’examinateur doit décider si les compétences cognitives préservées du patient sont suffisantes pour lui permettre de prendre une décision appropriée à la question spécifique posée.
Si un déficit cognitif significatif est détecté, l’examinateur doit réaliser une évaluation détaillée des compétences compensatoires susceptibles d’aider à surmonter les déficits. À cette évaluation neuropsychologique initiale, il convient d’ajouter des tests permettant d’évaluer spécifiquement certains composants de la prise de décision.
Pour ce faire, quelques tâches spécifiques sont disponibles, présentées dans le Tableau 3.
| Test | Évaluation spécifique |
| Iowa Gambling Task | Prise de décision en situation d’incertitude et apprentissage émotionnel |
| Cambridge Gambling Task | Risque connu et aversion au risque |
| Game of Dice Task | Risque explicite et planification |
| Balloon Analogue Risk Task | Impulsivité et propension au risque |
| Delay Discounting Task | Préférence pour les récompenses immédiates |
| Columbia Card Task | Régulation émotionnelle et sensibilité à la perte/récompense |
| Probabilistic Reversal Task | Flexibilité cognitive, sensibilité aux changements de contingence |
| Dilemmes moraux (p. ex. problème du tramway) | Raisonnement éthique et émotionnel |
Conclusions
La prise de décision n’est pas un processus purement logique et froid, ni exclusivement émotionnel. C’est le résultat d’une interaction dynamique entre multiples variables cognitives, émotions, contexte et expérience préalable.
Grâce à des méthodes cliniques, des tests standardisés et l’observation, le neuropsychologue peut identifier les altérations de cette capacité, contribuant au diagnostic, à la planification thérapeutique et à la prise de décisions éthiques et juridiques éclairées.
Comprendre ces processus en profondeur et évaluer leurs altérations avec des outils appropriés permettra de répondre adéquatement aux questions pour lesquelles l’évaluation a été conçue et, si nécessaire, de programmer les interventions cliniques les plus efficaces.
Bien qu’il subsiste des limitations méthodologiques, les avancées dans les modèles neuroscientifiques et les outils à validité écologique accrue continuent d’enrichir ce domaine, qui se situe à l’intersection de la cognition, de l’émotion et du comportement social.
Il semble que dans un avenir proche nous disposerons de modèles hybrides combinant évaluations traditionnelles et technologies avancées et, comme cela devient la norme en neuropsychologie, de l’utilisation de l’intelligence artificielle et de la prédiction algorithmique des performances.
Bibliographie
- Bechara, A., Damasio, H., & Damasio, A. R. (2000). Emotion, decision making and the orbitofrontal cortex. Cerebral Cortex. 10(3), 295-307.
- Damasio, A. R. (1994). Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. Putnam.
- Damasio, A. R. (1996). The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal cortex. Philosophical Transactions of the Royal Society B.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750
- Doya, K. (2008). Modulators of decision making. Nature Neuroscience, 11(4), 410–416. https://doi.org/10.1038/nn2077
- Ernst, M., & Paulus, M. P. (2005). Neurobiology of decision making: A selective review from a neurocognitive perspective. Biological Psychiatry, 58(8), 597–604. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.06.004
- Freedman, M., Stuss, D. T., & Gordon, M. (1991). Assessment of competency: The role of neurobehavioral deficits. Annals of Internal Medicine, 115(3), 203–209. https://doi.org/10.7326/0003-4819-115-3-203
- Glimcher, P. W. (2013). Neuroeconomics: Decision making and the brain. Academic Press.
- Heilbronner, S. R., & Hayden, B. Y. (2016). Dorsal anterior cingulate cortex: A bottom-up view. Annual Review of Neuroscience, 39, 149–170. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-070815-013952
- Kahneman, D. (2003). A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. American Psychologist.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica.
- Lebreton, M., & Lopez-Persem, A. (2022). Anatomy and disorders of decision-making. In Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809324-5.23889-1
- Lerner, J. S., Li, Y., Valdesolo, P., & Kassam, K. S. (2015). Emotion and decision making. Annual Review of Psychology, 66, 799–823. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115043
- Manes, F., Sahakian, B., Clark, L., et al. (2002). Decision-making processes following damage to the prefrontal cortex. Brain, 125(3), 624-639.
- Mateer C. A. (1999). Executive function disorders: rehabilitation challenges and strategies. Seminars in clinical neuropsychiatry, 4(1), 50–59. https://doi.org/10.1053/SCNP00400050
- Morelli, S. A., Sacchet, M. D., & Zaki, J. (2022). Common and distinct neural correlates of personal and vicarious reward: A quantitative meta-analysis. NeuroImage, 191, 42–53. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2019.02.024
- Robinson, H. W. (2016). Decision making by the book: How to choose wisely in an age of options. Discovery House.
- Rolls, E. T. (2019). The Brain, Emotion, and Decision-Making. Oxford University Press.
- Van der Pligt, J. (2015). Attitudes and decisions. In J. R. Eiser & J. Van der Pligt, Attitudes and Decisions (pp. 1–20). Psychology Press.
- Verdejo-García, A., & Bechara, A. (2009). A somatic marker theory of addiction. Neuropharmacology, 56, 48–62.

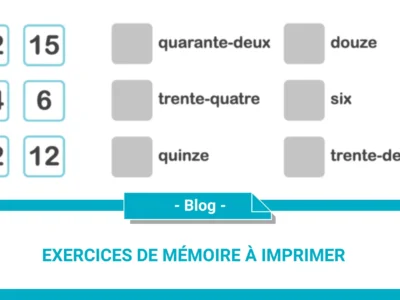
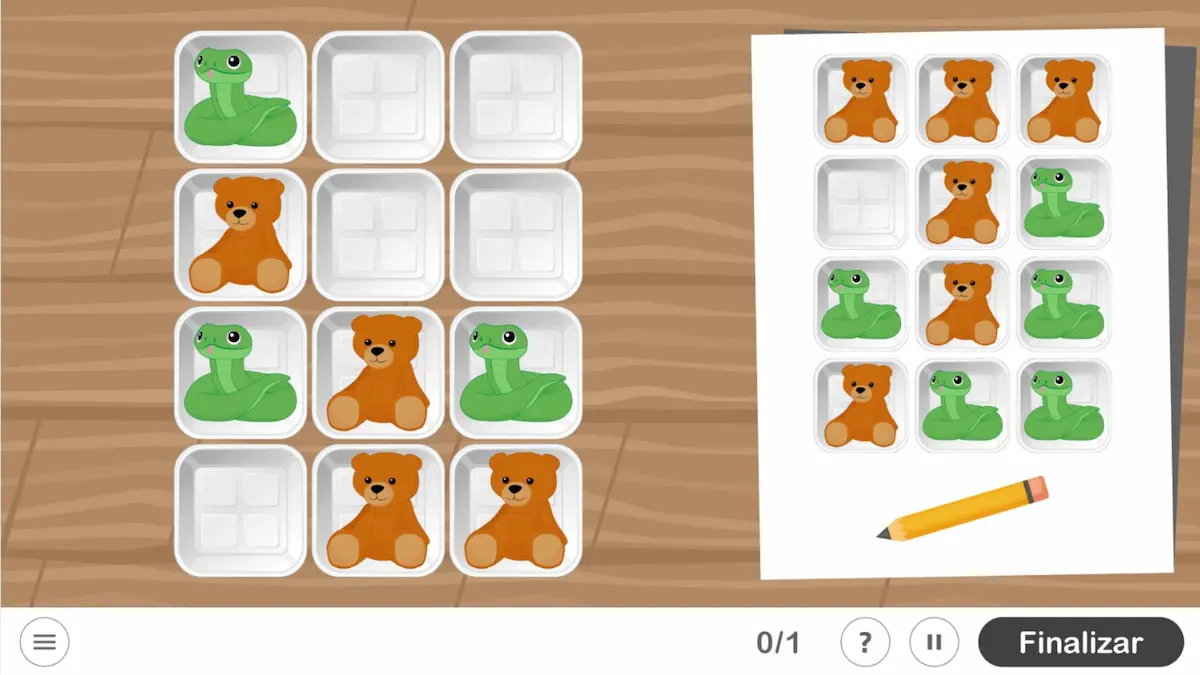



 La numérisation dans l’évaluation neuropsychologique
La numérisation dans l’évaluation neuropsychologique
Laisser un commentaire