Le neuropsychologue clinicien Aarón F. Del Olmo présente dans cet article ce qu’est la réserve cognitive, son fonctionnement et son rapport aux lésions cérébrales.
Certains disent que si le siècle dernier fut le siècle de la génétique, ce siècle dans lequel nous vivons est celui du cerveau. Et il est vrai qu’au fil des premières décennies, nous commençons à comprendre un peu comment le cerveau fonctionne et comment il interagit avec l’environnement pour nous aider à nous y adapter. Les études portant sur des personnes ayant subi un dommage cérébral ont beaucoup contribué, mais comme souvent, plus on en sait, plus de questions surgissent : comment se fait-il que certaines personnes évoluent de manière si différente lors de leur récupération alors qu’elles ont subi des dommages similaires ? Pourquoi parfois des lésions identiques n’entraînent-elles pas le même type d’atteinte clinique ? L’un des paradigmes qui tente d’apporter des réponses est celui de la réserve cognitive.
Ce n’est pas un paradigme récent, mais c’est un terme qui ces dernières années a commencé à prendre place dans nos échanges sur la neuropsychologie et les lésions cérébrales. À titre d’exemple, on peut citer l’augmentation du nombre de publications contenant ce thème dans leur titre (Source : PubMed), qui est passé de 183 au cours de la première décennie du XXIe siècle à 967 dans la décennie actuelle qui n’est pas encore terminée (vous pouvez voir l’évolution dans le graphique ci-dessous).

Réserve cérébrale est-elle la même chose que réserve cognitive ?
Cependant, le problème avec ce terme est de comprendre réellement sa signification et ce qu’il peut ou non apporter à notre pratique quotidienne. Il est donc intéressant de différencier la réserve cérébrale de la réserve cognitive, des termes qui sont à tort utilisés de façon interchangeable alors qu’ils reposent sur des hypothèses différentes. D’un côté, le terme réserve cérébrale provient des études post-mortem menées par Katzman et ses collaborateurs (1) sur un échantillon de personnes âgées en bonne santé et atteintes de maladie d’Alzheimer, qui ont révélé une absence de relation directe entre la charge amyloïde et les signes cognitifs observés. Ils ont expliqué que les cerveaux des personnes ayant supporté davantage de dommages, sans en manifester les symptômes de leur vivant, étaient plus volumineux. Cela a été directement lié à des facteurs génétiques, à l’intelligence en général (associée à des facteurs héréditaires) et à l’éducation formelle, qui influence le neurodéveloppement en générant une plus grande densité synaptique (2). Cependant, ce modèle reste quelque peu statique (il existe un même seuil pour tous au-delà duquel un dommage apparaît) et présente une certaine limitation en termes d’interventions. D’une certaine façon, il reflétait également des conceptions plus anciennes du fonctionnement cérébral (plus structurelles).
Ce terme a été jugé pertinent et a conduit à l’utilisation de mesures grossières de la taille du cerveau, comme la simple circonférence du crâne. Cependant, cette idée restait relativement limitée, surtout à mesure que progressait notre connaissance du fonctionnement cérébral, en partie grâce aux techniques d’imagerie fonctionnelle. En fait, sur la base de ce fonctionnement cérébral, Stern (3) a élaboré une autre hypothèse plus dynamique, partant du principe qu’il existe réellement des cerveaux plus efficaces ou dotés d’une plus grande capacité de compensation, sans qu’il soit nécessaire de les lier à leur taille. Autrement dit, certaines personnes peuvent maintenir de meilleures fonctions cognitives face à un dommage que d’autres, et par conséquent, ce seuil de capacité à supporter un dommage varierait grandement d’un individu à l’autre. Ce qui est le plus intéressant dans cette hypothèse, c’est qu’elle envisage la possibilité de modifier cette réserve (l’acquérir ou la perdre) en fonction du mode de vie, en identifiant les activités cognitivement stimulantes, l’activité physique ou l’aspect social comme moyens d’y parvenir.
Bien que ce soient deux modèles différents (même si la terminologie est parfois utilisée de manière lâche), on peut considérer qu’ils interagissent tous deux. Chacun de nous possède un capital génétique, mais c’est ce que nous en faisons qui déterminera si nous avons plus ou moins de réserve cognitive.
Comment fonctionne cette réserve ?
Le mot réserve fait référence à l’« accumulation » de quelque chose, de sorte qu’en théorie le terme réserve cognitive pourrait être compris comme une « accumulation de cognition ». Et pour cause, l’idée sous-tendant cette réserve est précisément de disposer d’un surplus de « cognition » pour rester fonctionnels lorsqu’un dommage cérébral survient (ou s’accumule progressivement). La principale base de cette accumulation est le terme neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à réagir à l’environnement et à en être modifié. Mais comme nous l’avons dit, pour le meilleur comme pour le pire.
La notion de neuroplasticité positive et négative (4), en fonction des habitudes de vie, nous donne assurément la possibilité de décider, à titre personnel, de la façon dont le temps traitera notre cerveau. Sur cette base, une hypothèse qui s’inscrit dans cette idée de neuroplasticité est celle du « use it or lose it » (5), signifiant que ce qui n’est pas utilisé finit par se détériorer, ou en termes cérébraux, que ce qui n’est pas stimulé perd de son efficacité. Ainsi, l’une des sources de réserve cognitive peut être la réalisation de activités nouvelles (et donc éloignées de l’automatisme) comportant une dimension cognitive. De cette manière, en favorisant cette efficacité cérébrale, on pourrait retarder l’expression clinique de l’évolution d’une maladie neurodégénérative ou, à tout le moins, compenser de façon plus efficace un dommage cérébral (6).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Disposons-nous d’outils en Espagne pour la mesurer ?
Le principal défi consiste généralement à mesurer cette réserve. Au cours de ces dernières décennies, la recherche a permis de mieux comprendre comment cette réserve peut se générer et aussi les éléments auxquels il faut prêter attention pour tenter de la quantifier (7,8). En Espagne, nous disposons pour le moment de plusieurs échelles pouvant être utiles. Par exemple, le Questionnaire de réserve cognitive (CRC) (9) comporte 8 items à noter qui recueillent des informations sur l’éducation formelle, l’éducation parentale, l’activité professionnelle, la formation musicale, entre autres, considérant ces éléments comme des « sources » de cette réserve cognitive.
D’autre part, nous avons également la Échelle de réserve cognitive (10) qui collecte la notation d’une série d’activités tant durant la jeunesse que durant l’âge adulte (et dans une version pour les personnes âgées) portant sur des aspects liés à la formation, aux loisirs ou à la dimension sociale.
Enfin, récemment validé chez les personnes âgées, nous disposons du questionnaire des activités cognitivement stimulantes (11), qui recense 10 activités pouvant être considérées comme génératrices de cette réserve cognitive ou, du moins, semblant être liées à un meilleur état du fonctionnement cognitif chez les personnes âgées.
Dans cette lignée, il est fort probable que nous verrons à l’avenir davantage de recherches qui nous éclaireront sur le fonctionnement de cette réserve cognitive, et peut-être plus important encore, comment apprendre à l’utiliser dans le contexte clinique pour évaluer l’évolution des personnes souffrant de lésions cérébrales et la manière de l’intégrer au traitement.
Bibliographie
- Katzman R, Aronson M, Fuld P, Kawas C, Brown T, Morgenstern H, et al. Development of dementing illnesses in an 80-year-old volunteer cohort. Ann Neurol. avril 1989;25(4):317-24.
- Satz P. Brain reserve capacity on symptom onset after brain injury: A formulation and review of evidence for threshold theory. Neuropsychology. 1993;7(3):273-95.
- Stern Y. What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. J Int Neuropsychol Soc JINS. mars 2002;8(3):448-60.
- Vance DE, Wright MA. Positive and negative neuroplasticity: implications for age-related cognitive declines. J Gerontol Nurs. juin 2009;35(6):11-7; quiz 18-9.
- Hultsch DF, Hertzog C, Small BJ, Dixon RA. Use it or lose it: engaged lifestyle as a buffer of cognitive decline in aging? Psychol Aging. juin 1999;14(2):245-63.
- Scarmeas N, Stern Y. Cognitive reserve and lifestyle. J Clin Exp Neuropsychol. août 2003;25(5):625-33.
- Schinka JA, McBride A, Vanderploeg RD, Tennyson K, Borenstein AR, Mortimer JA. Florida Cognitive Activities Scale: initial development and validation. J Int Neuropsychol Soc JINS. janvier 2005;11(1):108-16.
- Salthouse TA, Berish DE, Miles JD. The role of cognitive stimulation on the relations between age and cognitive functioning. Psychol Aging. décembre 2002;17(4):548-57.
- Rami L, Valls-Pedret C, Bartrés-Faz D, Caprile C, Solé-Padullés C, Castellví M, et al. Cuestionnaire de réserve cognitive. Valeurs obtenues chez une population âgée saine et atteinte de la maladie d’Alzheimer. Rev Neurol. 2011;52(4):195-201.
- León I, García-García J, Roldán-Tapia L. Estimating Cognitive Reserve in Healthy Adults Using the Cognitive Reserve Scale. PLOS ONE. 22 juillet 2014;9(7):e102632.
- Morales Ortiz M, Fernández A. Assessment of Cognitively Stimulating Activity in a Spanish Population. Assessment. 1er mai 2018;1073191118774620.

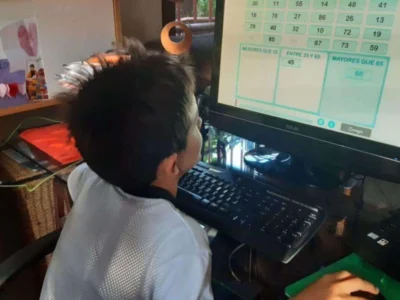
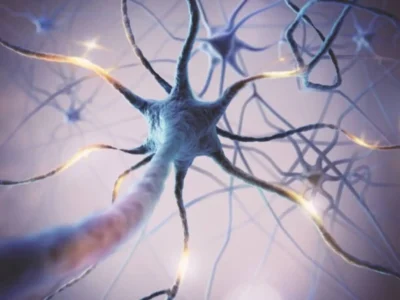


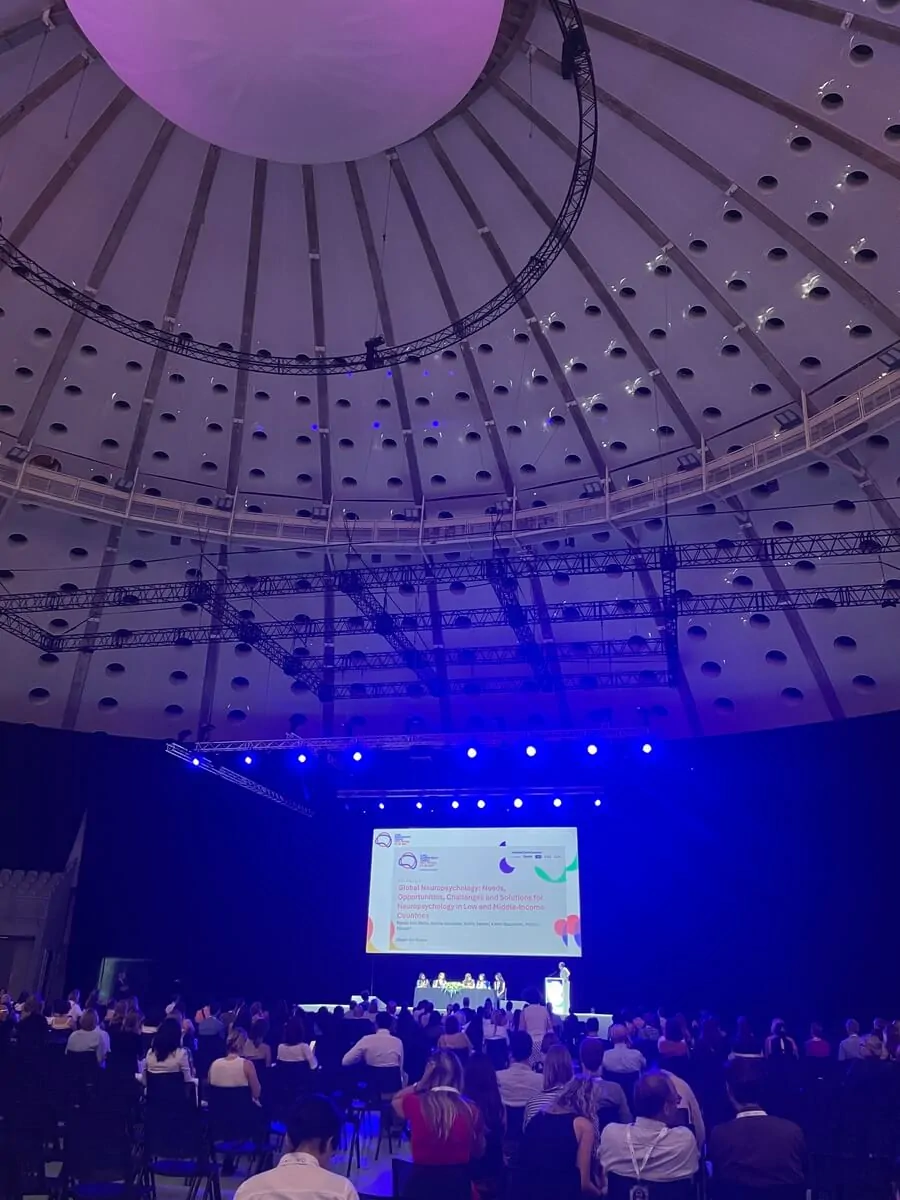

 Instructions en réhabilitation cognitive : méthodes, conception et efficacité
Instructions en réhabilitation cognitive : méthodes, conception et efficacité
Laisser un commentaire