La neuropsychologue Ainhoa Espinosa de Luzarraga répond aux questions relatives à sa présentation « Affectivité et sexualité après un dommage cérébral acquis » donnée à la NeuronUP Academy.
Questions sur la conférence d’Ainhoa Espinosa de Luzarraga sur le dommage cérébral acquis
1. Guillermo López-Tello Márquez : Pourrais-tu me donner des exemples d’activités pratiques à la fois en intervention individuelle et en groupe ?
Bonjour Guillermo. J’ai précisément conçu le guide clinique dans cet objectif : regrouper de nombreuses tâches réalisées lors des interventions et dont on me rapportait les effets bénéfiques, afin de faciliter le travail aux personnes intéressées. Visite mon site web et, si besoin, écris-moi pour que je t’envoie plusieurs exercices.
2. Ezequiel Larraza : Comment abordez-vous le sujet des jouets sexuels ?
Enchantée, Ezequiel. J’aborde justement ce sujet avec une prudence extrême, sachant que je ne suis pas experte dans ce secteur, mais que je suis la personne qui connaît bien les personnes atteintes de lésions cérébrales acquises (LCA) et qui recherche les alternatives susceptibles d’améliorer leur qualité de vie.
Si je devais t’indiquer les points clés à prendre en compte, je te dirais :
- Tout d’abord, tu dois étudier le modèle biographique et la valeur accordée à la sexualité de cette personne tout au long de son histoire ;
- Deuxièmement, bien connaître son profil cognitivo-comportemental pour pouvoir adapter la recherche du type de ressource et son utilisation.
Une fois cela fait, il est essentiel de parler du « pourquoi ». C’est-à-dire de ce qui lui manque, car il se peut que ce jouet n’apporte aucune aide et constitue une contrainte supplémentaire pour répondre à d’autres besoins affectifs.
N’oublie pas de présenter ou d’expliquer un modèle du désir dans lequel l’essentiel dépasse les organes génitaux et même le corps, et où ce sont les pensées, les images et les fantasmes qui nous rapprochent du plaisir. Ce modèle étendu du désir, où l’on considère le jouet comme un moyen de travailler ses pensées vers des idées de satisfaction, est indispensable.
Une fois qu’on estime que la personne a besoin de se reconnecter à son désir et à sa dimension corporelle et génitale, on recommandera :
- Chercher la ressource la plus simple, facile à manipuler et à nettoyer. Il convient de convenir si c’est un outil à utiliser en couple ou non, et de montrer l’engagement à respecter cet accord, par lequel on respecte la décision de l’autre partie (dans le cas d’un couple).
- Accompagner sa bonne utilisation, c’est-à-dire indiquer où le ranger pour garantir ta propre intimité et celle des personnes avec qui tu vis, ainsi que préciser avec qui partager cette expérience, tout en respectant toujours l’intimité de chacun, et laisser libre la créativité de la personne concernée.
- Ensuite, évaluer si l’ajout de cette ressource pendant un certain temps l’a rapproché de son univers de désir. Nous rappellerons toujours que l’organe érogène principal est le cerveau et vérifierons si cette ressource l’aide à se connecter aux pensées et aux sensations corporelles.
Ezequiel, sur mon site web, tu trouveras quelques articles dans lesquels j’ai partagé mes expériences d’utilisation de ces ressources. Je te joins le lien si cela peut t’être utile : https://neuropsicologiaysexualidad.com/la-posibilidad-de-recurrir-al-uso-de-otros-recursos-terapeuticos-como-son-los-juguetes-sexuales-para-una-mejor-salud-sexual/

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
3. Blanca Alcaráz : Face au refus de la personne affectée d’avoir des relations sexuelles suite à un dommage cérébral acquis, comment le partenaire doit-il réagir ?
Blanca, je suppose que tu es d’accord avec moi pour dire qu’il faut agir en toute liberté, comme dans tout autre aspect relationnel… Je pense que le rôle du thérapeute est d’accompagner, de montrer la réalité, de proposer des alternatives en validant les émotions et de permettre la prise de décisions. Autrement dit, inhérente aux relations de couple, il y a l’adaptation aux changements qui, parfois, avec le temps, pèsent trop sur l’un des partenaires et provoquent le désengagement, alors que dans d’autres cas cela ne se produit pas ; en tout état de cause, l’autonomie pour évaluer ses propres expériences revient à la personne concernée.
En tant que professionnels de la neuropsychologie, avec la personne concernée, nous devons explorer les causes de ce refus : peur de ne pas satisfaire les attentes des autres, absence de réponses physiologiques aux stimuli qui, avant la LCA, provoquaient du désir, apathie, détachement vis-à-vis de la relation avec cette personne, etc.
En tout cas, il serait essentiel que le suivi thérapeutique soit assuré par le neuropsychologue, afin d’éviter que le partenaire manque de soutien dans la recherche de réponses et dans le processus de réajustement à la situation de changement qu’ils vivent généralement.
4. Daniella Víquez : Depuis votre pratique, avez-vous observé que les changements parfois résultent de pertes, mais que des aspects positifs de la sexualité apparaissent également après une LCA ?
J’adore l’optimisme que tu transmets, Daniela. En vérité, j’ai observé des changements positifs chez certaines personnes, bénéfiques pour elles-mêmes, mais qui, par ailleurs, impliquaient un changement dans leur manière de se reconnecter à leur environnement, si bien que je ne me risquerais pas à dire si c’est positif ou non. Tout dépend de là où tu places le focus : sur la personne ou sur ses relations antérieures.
J’adore que tu poses cette question et, j’espère que ces personnes l’ont vécu comme quelque chose de positif après s’être réajustées suite à la LCA, merci !
5. Alba Martín : Comment penses-tu qu’on devrait aborder ce sujet si important dans le cadre des résidences pour personnes en situation de handicap ? Merci beaucoup.
En fait, Alba, j’ai dispensé plusieurs formations destinées au personnel médico-social de diverses résidences pour personnes en situation de handicap. Car il est prioritaire de travailler notre regard sur la sexualité des personnes que nous accompagnons dans notre travail et sur la manière dont nous, en tant qu’environnement, influençons leur quotidien dans leur propre « maison », c’est-à-dire la résidence.
Nous devons faire une place à la sexualité dans leurs « maisons ». Je considère qu’il est prioritaire de vérifier si nous offrons réellement, dans les résidences pour personnes en situation de handicap, un cadre garantissant les droits de chaque individu, quelles que soient ses conditions de santé, incluant le droit à la sexualité et à l’intimité. Si la santé sexuelle est le fruit d’un environnement qui reconnaît, respecte et exerce les droits sexuels, nous n’avons d’autre choix que de nous interroger sur le type d’environnement que nous proposons à ces personnes, puis d’apporter des modifications à notre manière d’influencer leurs vies.
À plusieurs reprises, ces formations ont été initiées précisément par le personnel chargé de l’accompagnement dans leurs « maisons », car ils montraient, en vertu de leur vocation, un intérêt pour les directives visant à garantir ce droit, mais aussi pour la prévention ou la gestion des conflits. Des expériences très gratifiantes que j’ai la chance de vivre dans ma profession d’enseignante.
6. Blanca Alcáraz : Comment aborder ce sujet quand on parle de personnes âgées ?
Bonjour de nouveau, Blanca. Eh bien, il s’agit d’intégrer la sexualité de la naissance jusqu’à la mort… Travailler sans infantilisation et en nous adaptant au public, en évitant l’âgisme qui apparaît si souvent, et en ajustant notre regard sur la sexualité, au-delà de celle liée à l’adolescence, à la procréation ou à un modèle exclusivement coïtal qui n’inclut pas toutes les étapes de la vie.
En fait, un autre groupe de la société qui subit des discriminations en raison de ses caractéristiques ou de ses conditions, en plus des personnes en situation de handicap, pourrait être celui des personnes âgées.
Le regard de la société sur l’érotisme des personnes âgées tend à être celui du rejet ou de l’occultation, jugé comme obscène, ou attribué à un manque de santé plutôt qu’à une santé positive. En témoignent parfois le manque d’intimité des couples dans les résidences ou la structure initiale qui part du principe qu’ils n’auront pas besoin d’intimité.
Heureusement, ces approches et perceptions de la longévité évoluent peu à peu et l’accent est mis de plus en plus sur la personne et sa dignité.
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
7. Carla María Lazzari : Dans le cas d’une désinhibition sexuelle élevée, comment faut-il aborder la situation : poser des limites et travailler à la réduire, ou au contraire laisser explorer et accompagner pour trouver des réponses ? Ou peut-être dialoguer et voir ce que souhaite la personne ? Je ne me suis pas encore trouvée face à ce type de situation.
Carla María, lors d’une autre formation avec des professionnels de la neuropsychologie, on m’a posé la question suivante : « Inclues-tu les personnes présentant une désinhibition sexuelle dans tes ateliers ? » Je pense que cela rejoint ton interrogation.
J’ai toujours défendu l’efficacité de l’intervention face aux difficultés comportementales, car les changements sont souvent significatifs lors de l’application des stratégies issues des modèles théoriques de modification du comportement. Éduquer à une santé sexuelle positive est également bénéfique et nécessaire pour les personnes qui, malheureusement, ont des difficultés à inhiber leurs réponses. Bien sûr, il faut préciser quelles conduites ne sont absolument pas autorisées et poser une limite claire, c’est indispensable de la part de tout leur entourage.
Mais, de plus, les ateliers qui abordent la sexualité humaine ne favorisent pas la désinhibition de leurs participants. Au contraire, l’expérience nous montre que ces groupes de travail renforcent :
- l’étude du comportement par l’équipe,
- l’accompagnement dans la prise de conscience des déficits,
- la possible anticipation pour l’évitement des conduites,
- les alternatives à la conduite à éliminer,
- et les clés de succès pour chaque cas particulier.
En amont de l’atelier et de manière générale, pour tenter de réduire un comportement désinhibé :
- La première étape consiste généralement à sélectionner un comportement précis, de la manière la plus objectivable et spécifique possible (par exemple, ne pas toucher la personne à qui il s’adresse).
- Ensuite, nous étudierons les antécédents ou les stimuli qui déclenchent ce comportement (lorsqu’il interagit individuellement et que ce n’est pas son tour).
- De même, nous analyserons les conséquences de ce comportement ou la réponse qu’il obtient de son entourage, ainsi que les bénéfices éventuels (par exemple, l’attention sociale).
Une fois dans le déroulement de l’atelier, nous tenterons de modifier cet apprentissage (antécédents et conséquences) qui maintient la désinhibition, nous enseignerons des stratégies de régulation comportementale et nous renforcerons la cognition sociale (sélection de réponses appropriées selon le contexte, la relation existante, etc.) et le raisonnement, en nous adaptant à leurs capacités cognitives.
Dans la même veine, à travers l’atelier, nous renforcerons l’estime de soi via le feedback des pairs avec lesquels, parfois, le comportement désinhibé se manifeste.
Par ailleurs, un bénéfice secondaire de traiter ce domaine est que l’on parvient également à éviter les risques en partageant la situation avec l’entourage. Dans son cas, nous expliquons les causes organiques du comportement (par exemple, cette réaction apparaît en raison de la lésion qu’il a subie, tout comme le manque de force de sa jambe). De cette façon, nous favorisons l’empathie envers la personne concernée et il est plus facile d’éviter d’attribuer des causes erronées à ce type de comportement.
Lorsque nous cherchons à réduire tout comportement, nous devons renforcer son absence. Autrement dit, nous récompensons toute autre réponse que celle que nous souhaitons modifier (par exemple, s’il se frotte les mains plutôt que de toucher l’autre personne). Si ce renforcement est obtenu pendant les séances de groupe par les pairs, et qu’il se prolonge en dehors de ces séances, il est très probable que l’intensité et la fréquence de la désinhibition diminuent avec le temps.
La mise en commun par tous les membres de l’équipe (kinésithérapeutes, orthophonistes, psychiatres, etc.) est essentielle pour la généralisation des apprentissages. Des consignes sont données pour que cette intervention comportementale s’étende à chaque moment relationnel, et qu’elle ne se limite pas aux seuls temps d’atelier.
De même, la famille est informée des consignes de prise en charge et la co-thérapie fonctionnera si l’évolution est partagée et régulièrement mise à jour.
En définitive, il s’agit de faciliter le développement de la personne concernée, de son entourage et de l’équipe professionnelle.
8. Victoria Hernández : Lorsque tu travailles déjà depuis deux mois sur le plan cognitif, comment pourrais-tu aborder le sujet de la sexualité sans que cela leur paraisse violent ?
Victoria, je suis sûre que tu disposes de compétences amplement suffisantes pour mettre à l’aise les personnes que tu accompagnes. À condition d’avoir développé ton regard global sur la sexualité et d’être donc prête à la diversité des réactions, il s’agit de gérer les émotions sous-jacentes à cette situation où l’on te confie une part d’intimité. Manifeste du respect et de la reconnaissance afin de pouvoir les soutenir comme dans d’autres domaines.
Dans d’autres dimensions de la vie, ils apprécient également que nous posions des questions, car cela témoigne d’une approche holistique. Par exemple, dès les premières années, j’abordais les éventuels changements liés au contrôle des sphincters ou je proposais un espace pour discuter de l’impact de la lésion afin de comprendre les implications émotionnelles… Et ce sont des sujets très intimes pour lesquels nous avons pris l’habitude de poser des questions lorsqu’il était nécessaire pour évaluer et apporter du soutien. Comment ne pas en faire de même pour la manière dont nous nous sentons en tant qu’êtres sexués !
Dans le contexte et au moment opportun, que tu connais déjà pour cette personne que tu as rencontrée, il serait conseillé de demander si elle estime qu’il existe des changements dans sa façon de se relier intimement ou si les modalités de satisfaction de ses besoins humains fondamentaux de tendresse, d’affection et de plaisir ont évolué. Valide son ressenti et prolonge la conversation uniquement si tu vois qu’elle se déroule naturellement ; sinon, reporte-la et fais appel à son entourage selon le cas. Propose tout simplement, sois un point de référence pour ces sujets et reste attentive ; offre la possibilité de poser toute question, tant à la personne qu’à son entourage.
9. Diana Miranda : Je suis étudiante en psychologie et je réalise mon mémoire de fin d’études sur une proposition d’intervention en sexualité et LCA. Je me demande si, dans le cas d’une intervention de groupe, il est préférable que les groupes soient hétérogènes ou homogènes en termes d’âge, de situation de couple, etc. ?
Diana, dans mes premières expériences, j’ai dû m’adapter aux besoins de la structure dans laquelle je travaillais, si bien je n’ai pas effectué ce type de sélections. Pourtant, je peux t’assurer que, tout comme dans d’autres ateliers de groupe où j’ai toujours encouragé l’hétérogénéité et mêlé des personnes aux vécus variés pour les bénéfices que cela apporte, j’ai également constaté les mêmes avantages dans ces ateliers dédiés à la sexualité.
Bien que, idéalement, je te dirais qu’un niveau cognitif similaire soit préférable, si tu peux constituer des groupes plus homogènes cognitivement, je pense que cela profite au déroulement de l’atelier. Si, en plus, tu arrives à choisir une autre variable (couples ou situations vécues), vas-y ; mais je ne crois pas que ce soit indispensable, car empathiser avec d’autres situations est également enrichissant.
Lorsqu’il s’agit de groupes de proches, je crois en revanche qu’il est bénéfique de partager le même lien avec la personne affectée, c’est-à-dire de constituer les groupes en fonction du degré de parenté ou de la relation : groupes de frères et sœurs de personnes affectées, de couples, de parents, etc.
Profite bien de ton mémoire de fin d’études, tu me raconteras. Merci.





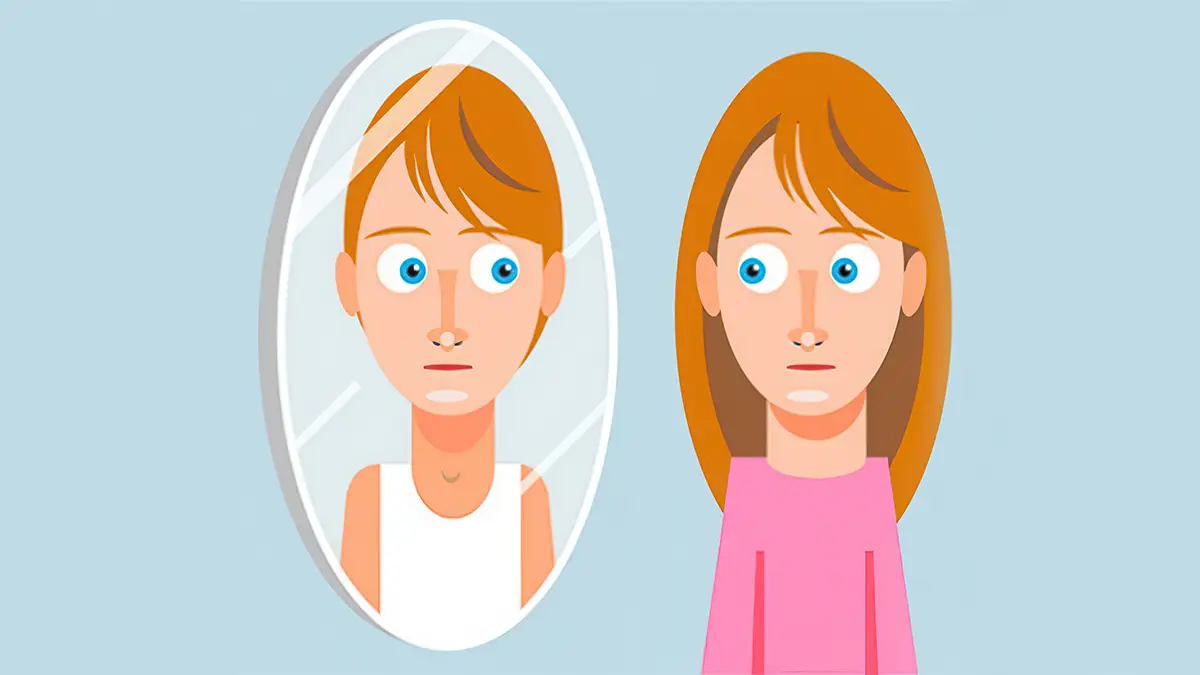
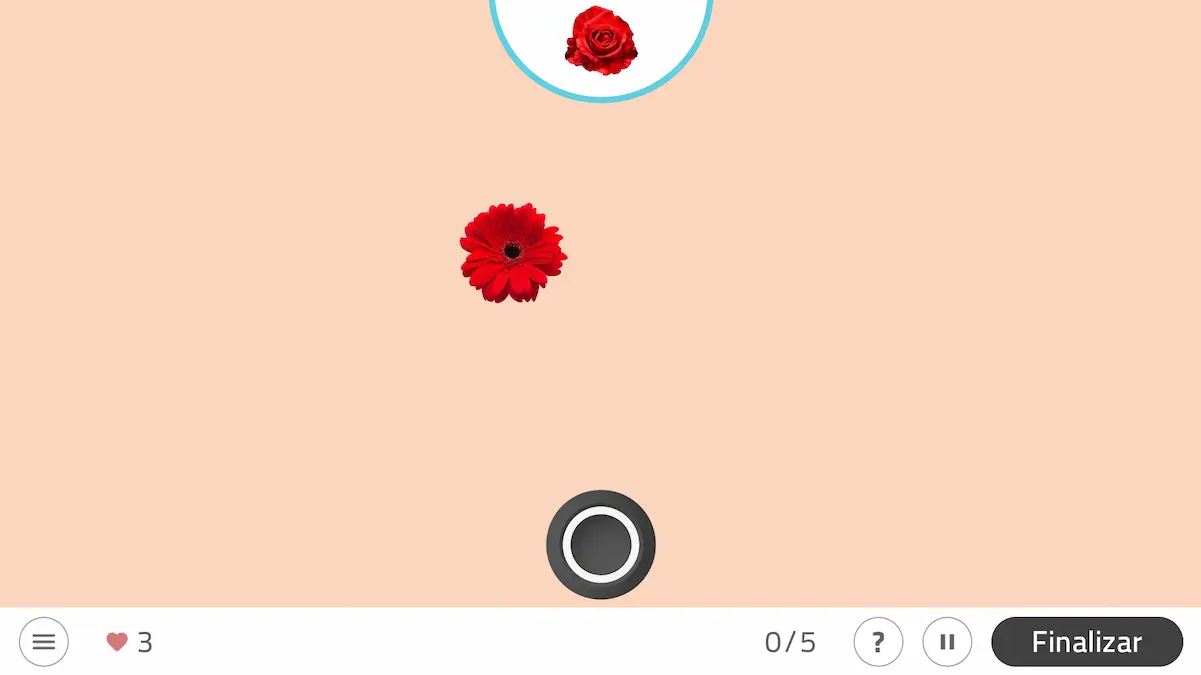
 Pourquoi utiliser NeuronUP2GO ?
Pourquoi utiliser NeuronUP2GO ?
Laisser un commentaire