Saviez-vous que la mémoire n’est pas un système unique et indivisible ? Depuis l’Asociación Murciana de Neurociencia, ils nous expliquent le concept non unitaire de la mémoire.
La mémoire
Une des capacités cognitives de base sur lesquelles repose l’adaptation de l’être humain aux exigences de l’environnement est la mémoire. En effet, ce processus cognitif est étudié dans de nombreux domaines de connaissance, pas seulement psychologiques.
Depuis qu’on a abandonné le concept unitaire de mémoire – qui définissait la mémoire comme un système unique et indivisible –, de plus en plus d’études, regroupées dans différentes disciplines et méthodologies, explorent les différents systèmes mnémoniques. Ceux-ci ont été recensés et classés, tant dans les approches classiques que dans les approches actuelles, en fonction de deux facteurs principaux : le cours temporel de la mémoire, d’une part, et le type d’information stockée, d’autre part.
Selon leur cours temporel, on pense que la formation de la mémoire suit une progression, depuis une forme brève et instable, qui se produit immédiatement après l’apprentissage, jusqu’à une forme plus stable et durable, qui se manifeste après une période de temps plus ou moins longue depuis l’acquisition de l’information.
Entre ces deux extrêmes se forme un continuum qui regroupe différents types de mémoire : mémoire sensorielle, mémoire à court terme, mémoire de travail et mémoire à long terme. Ces réservoirs de mémoire s’inscrivent dans les modèles « multiréservoirs ou multisystèmes » de la mémoire et se distinguent les uns des autres par la quantité d’informations qu’ils peuvent contenir et par la durée pendant laquelle l’information y est conservée.
D’autre part, ces types de mémoire sont considérés comme des processus continus englobant des étapes spécifiques.
Étapes spécifiques
- Acquisition : apprentissage.
- Consolidation : mémoire.
- Récupération.
- Re-consolidation : C’est l’étape la plus récente. De nombreuses études en neurobiologie ont confirmé son indépendance.
La distinction selon le contenu englobé par le système de mémoire s’est généralement fondée sur l’étude de patients présentant des lésions cérébrales spécifiques. Plus précisément, on a observé que ces patients présentaient des altérations mémorielles spécifiques.
Par exemple, le patient J.P. avait des difficultés à améliorer ses performances dans des tâches dépendant de la répétition et de la mise en œuvre de compétences acquises auparavant, tandis que d’autres compétences restaient intactes ; ainsi, J.P. était capable d’évoquer consciemment un événement passé.
De cette spécificité de la mémoire est née une autre classification, fondée sur le contenu de l’information, qui a entraîné la scission de la mémoire à long terme en deux types : la mémoire déclarative ou explicite et la mémoire non déclarative ou implicite.
Types de mémoire à long terme
1. Mémoire déclarative ou explicite
La mémoire déclarative se charge de coder les informations relatives à des événements biographiques et à la connaissance d’événements spécifiques. En ce sens, elle implique un effort de la personne pour se remémorer des informations déjà survenues, appelé aussi souvenir intentionnel.
En général, son rappel est souvent déclenché par un stimulus évocateur qui était présent au moment du codage de l’information et qui facilite l’évocation.
Systèmes de la mémoire déclarative
Les trois systèmes inclus dans la mémoire déclarative sont :
- La mémoire sémantique,
- la mémoire épisodique,
- la mémoire de reconnaissance, un type spécial de mémoire qui fera l’objet de cette thèse.
2. Mémoire déclarative ou implicite
D’autre part, la mémoire implicite implique les habiletés ou compétences perceptives, motrices et cognitives déjà acquises et qui ne peuvent être récupérées que par l’action, étant impossible à « déclarer » verbalement. Dans ce cas, le souvenir est quantifié différemment : on considère qu’il y a eu apprentissage implicite si l’exécution de certaines tâches s’améliore.
Par conséquent, ce type de mémoire se manifeste lorsque des changements de comportement résultent d’un apprentissage antérieur dont la personne n’a pas conscience.
Exemples de mémoire déclarative ou implicite
Quelques exemples de mémoire implicite sont :
- Le conditionnement classique,
- les mécanismes de priming,
- la mémoire procédurale.
Conclusion
Globalement, on en conclut que la mémoire n’est pas un système unitaire indivisible, mais qu’elle se compose de différents systèmes fonctionnels qui diffèrent par leur cours temporel, par le contenu de l’information stockée et, en outre, par les bases neuronales qui les sous-tendent.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Bibliographie
- Carretié, L. (2016). Anatomía de la mente (2a ed.). Madrid, España: Pirámide.
- Phelps, E. A. (2004). Human emotion and memory: interactions of the amygdala and hippocampal complex. Current opinion in neurobiology, 14(2), 198-202.
- Rugg, M. D., Mark, R. E., Walla, P., Schloerscheidt, A. M., Birch, C. S. y Allan, K. (1998). Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory. Nature, 392(6676), 595-598.
- Squire, L. R. (1992). Memory and the hippocampus: a synthesis from findings with rats, monkeys, and humans. Psychological review, 99(2), 195.
- Tobias, B. A., Kihlstrom, J. F. y Schacter, D. L. (1992). Emotion and implicit memory. The handbook of emotion and memory: Research and theory, 1, 67-92.

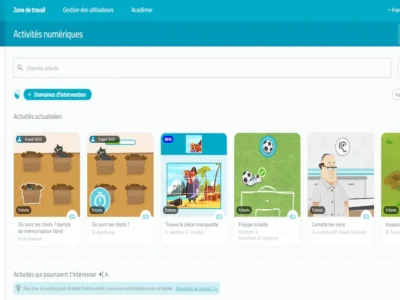

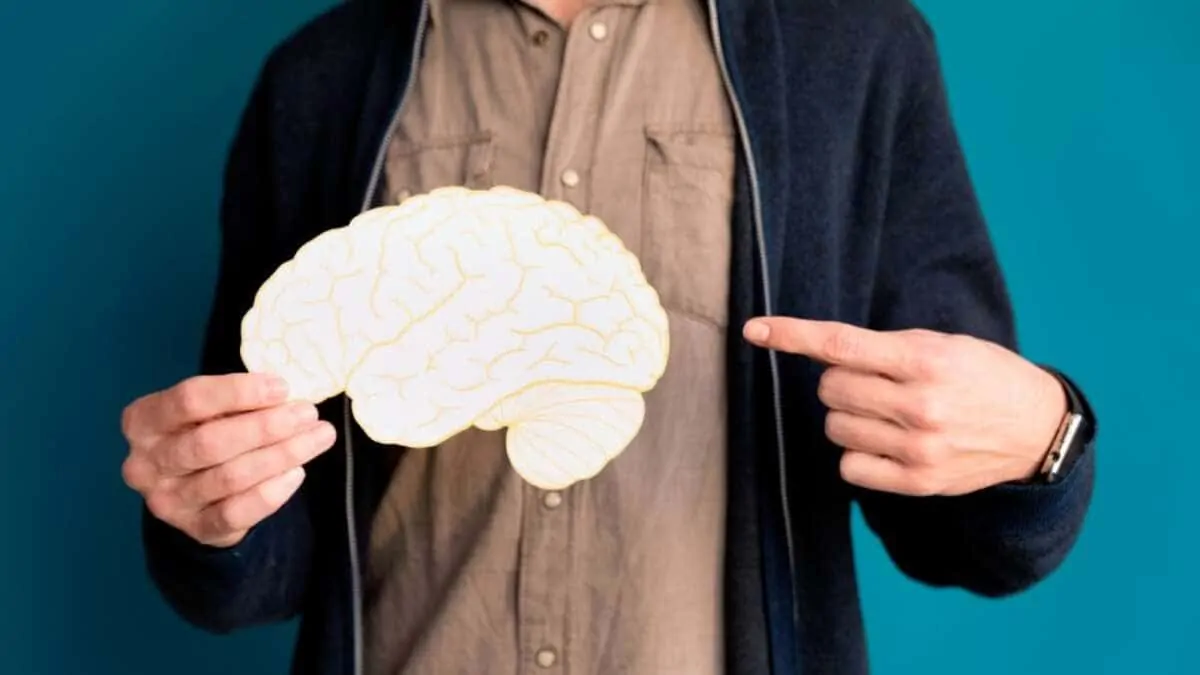


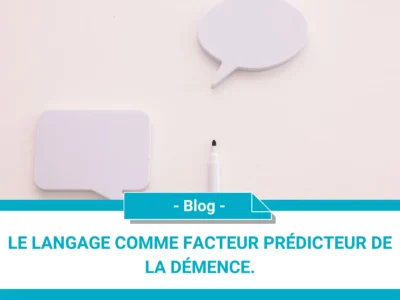
 Le syndrome post-commotionnel et la rééducation neuropsychologique
Le syndrome post-commotionnel et la rééducation neuropsychologique

Laisser un commentaire