La psychologue clinicienne Daniela Ramos Usuga explique dans cet article le processus de rééducation de l’attention sélective.
L’attention est une fonction cognitive complexe qui a été étudiée sous divers angles, allant de la neuropsychologie à la neuroscience cognitive, en passant par la psychométrie et l’électrophysiologie. Cela a conduit à l’élaboration de multiples modèles visant à expliquer cette capacité selon différentes perspectives.
Par exemple, la neuroscience cognitive cherche à identifier les zones cérébrales les plus impliquées dans les processus attentionnels, comme le cortex préfrontal et sensoriel, ainsi que des structures sous-corticales telles que le thalamus optique, le corps strié (noyau caudé et lenticulaire), les noyaux septaux et de Meynert, et le cervelet1.
En neuropsychologie, le modèle le plus influent est le modèle clinique de Sohlberg et Mateer2, qui a été établi sur la base de l’observation des principaux déficits attentionnels chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien. À partir de ces observations cliniques, ces auteures ont défini l’attention comme une capacité multidimensionnelle composée de cinq niveaux interconnectés de manière hiérarchique : l’attention focalisée, soutenue, sélective, alternée et divisée.
Dans les sections suivantes, nous aborderons en détail l’attention sélective, sa définition, les troubles qui peuvent affecter son fonctionnement, ainsi que son évaluation et sa rééducation.
Qu’entend-on par attention sélective ?
C’est la capacité à maintenir un comportement nécessitant une réponse motrice et/ou cognitive sans être perturbé par des stimuli distracteurs ou concurrents.
En se basant sur le modèle de Sohlberg et Mateer2 et la relation hiérarchique qu’ils établissent entre les différents niveaux d’attention, toute activité nécessitant une attention sélective suppose d’abord une capacité minimale à maintenir l’attention. Prenons un exemple courant : lire un journal dans le métro.
Dans un tel environnement, de nombreux stimuli distracteurs sont présents, tant visuels qu’auditifs, comme le bruit du métro, l’annonce des stations, les conversations et les mouvements des passagers, etc. Pour mener à bien une activité demandant de la concentration, comme lire un journal et comprendre son contenu, il est nécessaire de maintenir son attention sur la lecture tout en inhibant ces distractions.
C’est cela que nous appelons attention sélective : la capacité à sélectionner les informations pertinentes sur lesquelles nous allons focaliser notre attention de manière soutenue. Par conséquent, un bon fonctionnement de l’attention soutenue est un prérequis indispensable au bon exercice de l’attention sélective.
Obtenez 10 activités pour la rééducation et la stimulation cognitive à utiliser avec vos patients
Que se passe-t-il lorsque l’attention sélective est altérée ?
Une altération de l’attention sélective se traduit par une plus grande distractibilité face à des stimuli non pertinents ou inutiles pour accomplir la tâche requise. Ces distracteurs peuvent être externes (ex. bruit, mouvements) ou internes (ex. pensées, douleur)2. Les recherches sur l’attention dans diverses pathologies ont montré qu’elle est particulièrement affectée dans certaines populations cliniques.
Attention sélective et dépression
Par exemple, les personnes souffrant de dépression affichent une performance significativement réduite aux tests d’attention sélective. La rumination mentale, caractéristique de ces patients, agit comme un distracteur interne qui entraîne une diminution de la vigilance.
Attention sélective et schizophrénie
Les personnes atteintes de schizophrénie éprouvent également de grandes difficultés à distinguer les informations pertinentes des informations non pertinentes, ce qui signifie que n’importe quel stimulus peut capter momentanément leur attention1,3.
D’autres troubles, tels que la maladie d’Alzheimer et le Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité (TDAH), présentent également une altération de cette fonction3,4.
Ces déficits ne constituent pas seulement un obstacle à l’accomplissement des activités quotidiennes (ex. incapacité à suivre une conversation sans se laisser distraire), mais ils entravent également la rééducation, notamment lorsque celle-ci se déroule dans des environnements stimulants (ex. faire ses courses en supermarché dans le cadre d’une thérapie en ergothérapie)2.
Évaluation de l’attention sélective
L’attention est l’une des fonctions cognitives fondamentales dans toute évaluation neuropsychologique. Pour cette raison, divers outils ont été développés afin d’en mesurer les différentes composantes. Parmi les tests les plus couramment utilisés pour évaluer l’attention sélective figurent le test d2, le Test of Everyday Attention et le test de Stroop Couleurs et Mots.
Test d2
Ce test de barrage demande au participant de repérer et barrer un stimulus cible (la lettre “d” avec deux traits) présenté parmi d’autres stimuli distracteurs (lettres “d” et “p” avec 1, 3 ou 4 traits).
Test of Everyday Attention
Le Test of Everyday Attention (TEA)6 pour adultes et le Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)7 pour enfants incluent des activités écologiques permettant d’évaluer l’attention soutenue, divisée, contrôlée et alternée.
Concernant l’attention sélective, l’une des tâches de la version adulte consiste en un ascenseur qui émet un son spécifique lorsqu’il monte d’un étage, différent du son émis lorsqu’il descend. La tâche du participant est de compter les fois où l’ascenseur monte, tout en inhibant les sons distracteurs8.
Test Stroop des couleurs et des mots
Il s’agit d’un test très populaire permettant d’évaluer l’inhibition cognitive, l’attention sélective et la vitesse de traitement.
Il est composé de trois épreuves où le participant doit :
- Lire le plus rapidement possible les noms de trois couleurs : bleu, vert et rouge (Stroop mots),
- Nommer la couleur des stimuli représentés par « XXXX » (Stroop couleurs),
- Nommer la couleur de l’encre utilisée pour imprimer les noms des couleurs, tout en inhibant leur lecture (Stroop mot-couleur).
Il est essentiel d’effectuer une évaluation complète de l’attention, et pas seulement d’en analyser un type isolément.
En complément de l’évaluation psychométrique, il est recommandé de recueillir des données qualitatives sur le fonctionnement de l’attention en dehors du cabinet. Cela peut se faire en menant des entretiens avec les patients et leurs proches, afin d’identifier les situations où les déficits attentionnels sont les plus handicapants. Ces informations seront précieuses pour concevoir une intervention adaptée.
Rééducation de l’attention sélective
Comme pour d’autres fonctions cognitives telles que la mémoire, la rééducation de l’attention sélective doit se faire en définissant des objectifs généraux et spécifiques adaptés aux besoins de chaque patient. L’intervention doit être personnalisée, visant à restaurer, maintenir ou améliorer la fonction cognitive à travers une pratique guidée et organisée par niveaux de difficulté. Il est également crucial de prendre en compte les autres types d’attention afin d’intégrer ces éléments dans le programme de rééducation.
Par exemple, renforcer l’attention soutenue peut favoriser la restauration de l’attention sélective. De plus, l’objectif final étant de réduire l’impact du déficit attentionnel sur la vie quotidienne, l’efficacité de la rééducation doit être mesurée en fonction des améliorations observées dans la vie courante, et pas seulement via les résultats obtenus aux tests neuropsychologiques.
Outils pour la rééducation de l’attention sélective
Un autre aspect essentiel de la rééducation concerne le choix des outils à utiliser. Différents supports peuvent être employés selon les besoins du patient (ex. en tenant compte de la mobilité), allant des tâches classiques sur papier-crayon, comme les mots mêlés, aux technologies plus modernes telles que la réalité virtuelle. L’utilisation d’activités basées sur des situations de la vie quotidienne est de plus en plus répandue, car elle apporte une plus grande validité écologique.
À cet égard, la plateforme NeuronUP développe une série d’activités reproduisant des tâches du quotidien sollicitant l’attention sélective. Étant donné que nous sommes continuellement exposés à de nombreux stimuli, il est possible de concevoir des exercices inspirés de situations réelles ayant une visée thérapeutique.
Essayez NeuronUP 7 jours gratuitement
Vous pourrez travailler avec nos activités, concevoir des séances ou effectuer des réhabilitations à distance
Cependant, pour mener à bien ce processus, il est important de prendre en compte plusieurs variables :
- Utilité de la tâche,
- Public cible,
- Type de stimuli utilisés (auditifs, visuels ou les deux),
- Design (couleur, taille, mouvement, etc.),
- Critères d’évaluation (réponses correctes, types d’erreurs, temps de réponse, etc.),
- Paramètres de contrôle pour structurer l’activité de manière optimale.
De même, il est essentiel de s’appuyer sur un modèle théorique justifiant l’approche du programme de rééducation.
En définitive, il ne fait aucun doute que la neuropsychologie clinique a connu une évolution positive en peu de temps et continue de se développer grâce à des initiatives comme celles-ci, qui constituent une avancée significative dans un domaine aussi essentiel que la rééducation neuropsychologique.
Bibliographie :
- Rebollo, M. A., & Montiel, S. Attention et fonctions exécutives. Revue de neurologie. 2006;42(2):S3-S7.
- Sohlberg MM, Mateer CA. Improving Attention and Managing Attentional Problems. Annals of the New York Academy of Sciences. 2006;931(1):359–75.
- Egeland, J., Rund, B. R., Sundet, K., Landrø, N. I., Asbjørnsen, A., Lund, A., … & Hugdahl, K. Profil attentionnel dans la schizophrénie comparé à la dépression : effets différentiels sur la vitesse de traitement, l’attention sélective et la vigilance. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2003;108(4):276-284.
- dos Santos Assef, E. C., Capovilla, A. G. S., & Capovilla, F. C. Test Stroop informatisé pour évaluer l’attention sélective chez les enfants atteints de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. The Spanish Journal of Psychology. 2007;10(1):33-40.
- Brickenkamp, R. (1962). Aufmerksamkeits-Belastungs-Test Handanweisung d-2.
- Robertson, I. H., Ward, T., Ridgeway, V., & Nimmo-Smith, I. (1994). The Test of Everyday Attention (TEA). San Antonio, TX : Psychological Corporation.
- Manly, T., Anderson, V., Nimmo-Smith, I., Turner, A., Watson, P., & Robertson, I. H. Évaluation différentielle de l’attention chez les enfants : The Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch), échantillon normatif et performances chez les enfants atteints de TDAH. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2001;42(08):1065-1081.
- Chan, R. C., Lai, M. K., & Robertson, I. H. Structure latente du Test of Everyday Attention dans un échantillon chinois non clinique. Archives of Clinical Neuropsychology. 2006;21(5):477-485.
- Golden, C. J. (1994). STROOP : Test des couleurs et des mots : Manuel. TEA éditions S.A.


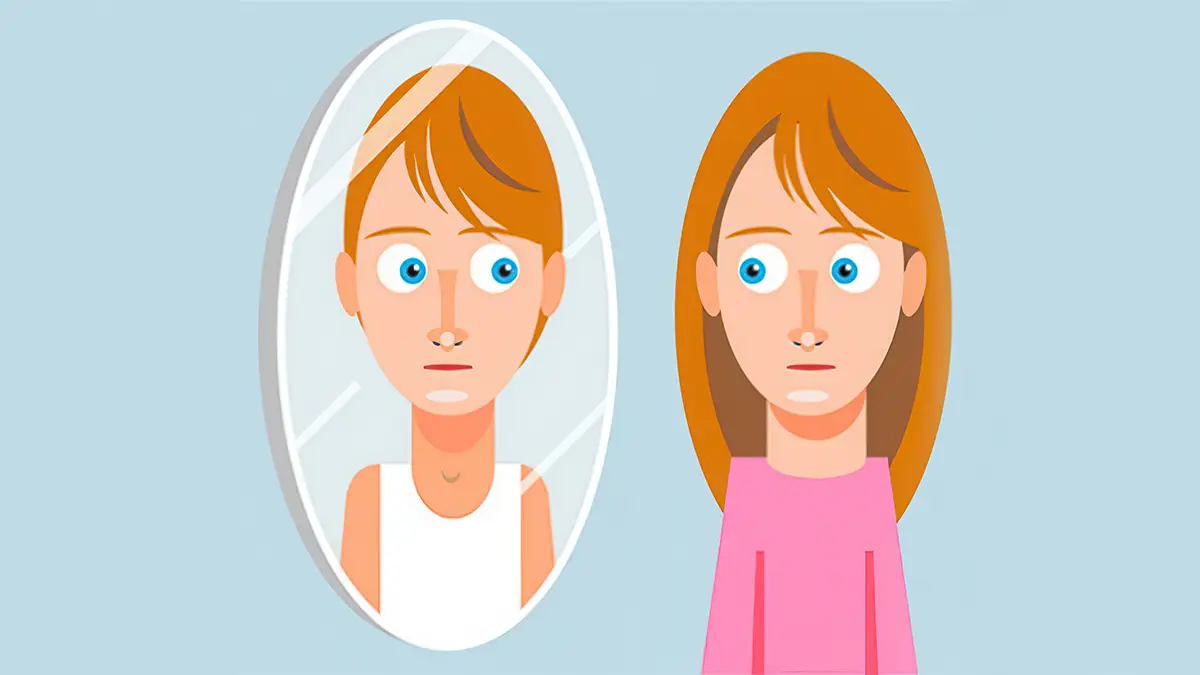




 Problèmes d’attention : qu’est-ce que c’est, quels sont les types et les symptômes ?
Problèmes d’attention : qu’est-ce que c’est, quels sont les types et les symptômes ?
Laisser un commentaire