Le Docteur en biomédecine Pablo Barrecheguren nous explique la structure de la mémoire et nous dit à quoi sert chaque type de mémoire.
Nous avons tendance à considérer nos capacités intellectuelles comme des blocs uniques, alors que des compétences telles que la mémoire sont plutôt une structure composée de différents départements. Chacun d’eux est interconnecté mais en même temps séparé.
Une preuve en est donnée par les maladies qui affectent la mémoire, comme c’est le cas de la maladie d’Alzheimer : le Dr Alzheimer lui-même avait remarqué que les patients perdaient certains souvenirs avant d’autres, puisque sa première patiente diagnostiquée, Auguste Deter, pouvait énoncer les mois de l’année sans la moindre erreur, mais était incapable de répondre si on lui demandait quel était le onzième mois de l’année.
Ou dans le cas d’artistes atteints d’Alzheimer, les patients sont souvent capables de continuer à jouer d’un instrument ou à peindre, même s’ils ont du mal à se souvenir de leur propre nom complet.
Et un autre exemple est le syndrome de Kleine-Levin, un trouble caractérisé par des épisodes durant lesquels les patients vivent des modifications de comportement, dorment de 12 à 21 heures par jour et présentent des troubles de la mémoire, précisément dans la mémoire de travail (qui est chargée de stocker temporairement l’information pendant que nous effectuons une tâche).
Mémoire à long terme
Mais lorsque nous parlons de mémoire en général, nous faisons habituellement référence à la mémoire à long terme, celle qui stocke l’information pendant des jours ou même des décennies, et qui se divise en deux catégories :
- Mémoire implicite, qui est celle que nous utilisons pour accomplir des actions telles que nouer nos lacets, danser ou faire du vélo.
- Mémoire déclarative, qui englobe toutes nos connaissances conscientes et qui se subdivise à son tour en deux sous-sections :
- La mémoire sémantique, qui regroupe tout ce que nous savons grâce à l’étude, depuis la voie métabolique du cycle de Krebs, les capitales de l’Europe, jusqu’au fait de savoir que le climat en Écosse est pluvieux alors que nous n’y avons jamais mis les pieds.
- La mémoire épisodique correspond à nos souvenirs personnels. Par exemple, si nous savons qu’il pleut en Écosse parce que nous nous rappelons qu’il pleuvait lors de nos vacances, c’est un souvenir épisodique.
Ces divisions en sous-types de mémoire ne sont pas arbitraires, car on a observé des différences fonctionnelles entre elles.
Par exemple, nous savons qu’il est probable que les êtres humains mémorisent presque toutes leurs expériences tout au long de leur vie (mémoire épisodique). Le problème est que mémoriser une information et la rappeler sont deux tâches très différentes…
Processus multisystémique
L’étude du cerveau indique que les lobes temporaux jouent un rôle crucial dans le stockage des souvenirs, et il est même possible de provoquer artificiellement des réminiscences : si l’on place des électrodes sur ces zones chez un patient et qu’on les stimule, celui-ci se souvient dans certains cas de mémoires complètement oubliées, au point de parfois vivre des hallucinations complètes où il revit des moments de son passé.
Ce phénomène se produit également chez des patients qui développent des problèmes dans ces régions. Le cas d’une vieille dame irlandaise est documenté : elle s’est réveillée un jour en entendant des chansons de son enfance (des morceaux qu’elle avait oubliés depuis des décennies).
La musique a résonné dans sa tête pendant des mois et ne s’est tue que lorsqu’elle s’est remise d’une petite thrombose touchant son lobe temporal droit.
Lorsqu’on parle de mémoire, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit d’un processus multisystémique qui implique également des zones du cerveau telles que l’hippocampe (particulièrement important pour la mémoire spatiale) et les lobes frontaux (très impliqués dans la récupération des souvenirs stockés).

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Un peu d’oubli
C’est très intéressant de constater qu’au sein du monde de la mémoire existe l’opposé des maladies neurodégénératives : l’oubli. Il existe des personnes dotées de capacités mnémotechniques qui ressemblent carrément à des super-héros.
Les cas les plus remarquables, bien que numériquement très rares, sont ceux de personnes qui possèdent une « mémoire autobiographique hautement supérieure » (HSAM, de l’anglais highly superior autobiographical memory). Ces personnes sont capables de se rappeler avec une précision extrême presque toute leur vie.
Par exemple, on pourrait leur demander ce qu’ils faisaient il y a vingt ans à neuf heures du soir, et ils nous diraient ce qu’ils cuisinaient à ce moment-là, les vêtements qu’ils portaient, l’odeur qui régnait dans la cuisine et tout ce qu’ils avaient fait au cours de cette journée.
Le problème, c’est que ces personnes sont littéralement incapables d’oublier, c’est pourquoi on leur recommande, dans la mesure du possible, de mener une vie tranquille, car l’impossibilité d’oublier complique grandement la guérison des traumatismes émotionnels.
Par exemple, un conseil médical est de ne pas s’engager dans l’armée. Ainsi, de façon ironique, le chemin vers une mémoire sans problème passe par un peu d’oubli.
Bibliographie
- Aslihan Selimbeyoglu and Josef Parvizi. (2010). Electrical stimulation of the human brain: perceptual and behavioral phenomena reported in the old and new literature. Frontiers in Neurology. Volume 4, Article 46.
- Draaisma, D. (2012). Alzheimer, supongo. Editorial Ariel.
- Joshua Jacobs, Bradley Lega, and Christopher Anderson. (2012). Explaining How Brain Stimulation Can Evoke Memories. Journal of Cognitive Neuroscience. 24:3, pp. 553–563.
- Miglis, M. G. & Guilleminault, C. (2014). Kleine-Levin syndrome: A review. Nature and Science of Sleep, 6, 19–26.
- Nanthia Suthana & Itzhak Fried (2014). Deep Brain Stimulation for Enhancement of Learning and Memory. Neuroimage, 85(0 3): 996–1002
- Richard W. Murrow. (2014). Penfield’s prediction: a mechanism for deep brain stimulation. Frontiers in Neurology. Volume 5, Article 213.
- Sacks, O. (2002). Reminiscencias. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Editorial Anagrama.
- Schacter, D. (2001). Los siete pecados de la memoria: cómo olvida y recuerda la mente. Editorial Ariel.

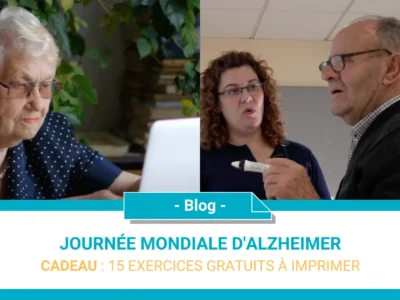
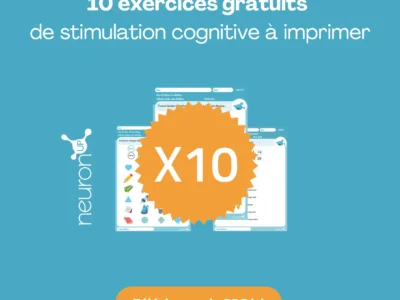

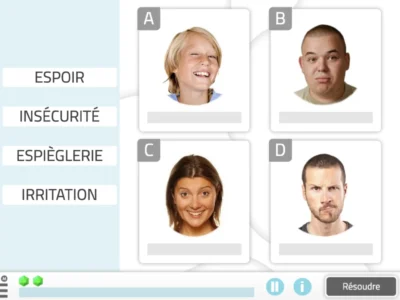


 Jeux vidéo contre les troubles neurologiques : l’exemple pionnier contre l’amblyopie
Jeux vidéo contre les troubles neurologiques : l’exemple pionnier contre l’amblyopie
Laisser un commentaire