Dans cet article, nous abordons la relation entre l’attention et la vitesse de traitement, en analysant s’il s’agit d’un même processus cognitif ou de mécanismes différenciés.
Introduction
Les processus attentionnels et la vitesse de traitement constituent deux éléments cognitifs de grande importance en neuropsychologie actuelle. Ils sont étroitement liés, si bien que, bien qu’ils constituent des constructions différenciables, ils sont souvent abordés conjointement.
Dans la pratique clinique et les activités quotidiennes, ces deux fonctions opèrent souvent de manière interdépendante, et il a été observé qu’une altération de l’un de ces deux domaines a un impact notable sur l’autre (Ríos et al., 2012 ; Salthouse, 2000). En outre, au fil de l’histoire, les mécanismes attentionnels ont été étudiés à l’aide de nombreuses tâches expérimentales, parmi lesquelles se distinguent celles qui mesurent les temps de réaction, unifiant ainsi, dans une certaine mesure, les processus et les instruments de mesure. Ces raisons peuvent expliquer, au moins en partie, pourquoi l’étude de l’attention et de la vitesse de traitement a été intimement liée et abordée de manière conjointe.
Cependant, certains auteurs ont souligné que la vitesse de traitement est un élément de la cognition ayant sa propre entité et qu’elle pourrait être étudiée spécifiquement (Bessel, 1820 ; Donders, 1868 ; Kant, 1798 ; Muller, 1801 ; Ríos et al., 2004 ; Salthouse, 2000 ; Schneider et Schiffrin, 1977 ; Spikman et al., 2000 ; Von Helmholtz, 1821-1894). Aujourd’hui, de nombreuses découvertes indiquent que la vitesse de traitement, et sa perturbation — la lenteur dans le traitement — constitue un élément fondamental pour le diagnostic et le traitement des troubles du système nerveux (DeLuca et Kalmar, 2008).
Attention et vitesse de traitement
Qu’est-ce que l’attention et la vitesse de traitement ?
D’une part, l’attention est un ensemble complexe de processus ou de mécanismes cognitifs visant à maintenir un niveau d’activation permettant le traitement de l’information, ainsi qu’à orienter, sélectionner et maintenir ce traitement sur certains stimuli et actions pertinents (Posner et Petersen, 1990 ; Petersen et Posner, 2012). D’autre part, la vitesse de traitement fait référence au rythme auquel le cerveau reçoit, analyse et produit des réponses face aux stimuli (Ríos et Periañez, 2010), ce qui affecte non seulement l’attention, mais aussi le fonctionnement d’autres processus comme la mémoire, le langage, les fonctions exécutives ou la cognition sociale.
Ces définitions permettent de repérer certaines différences entre ces deux mécanismes.
Bases neuroanatomiques de l’attention et de la vitesse de traitement
À cela s’ajoute le fait que le substrat neuroanatomique de chacun d’eux renforce encore l’existence de différences significatives.
Un des modèles les plus pertinents dans le domaine de l’attention propose l’existence de trois réseaux attentionnels :
- le réseau d’alerte (lié à l’activation générale et au maintien de l’état de vigilance) ;
- le réseau d’orientation (chargé de l’orientation et du déplacement du foyer attentionnel) ;
- et le réseau exécutif (impliqué dans la supervision et le contrôle de l’attention).
Ces réseaux sont liés à des structures cortico-sous-corticales raisonnablement définies (Petersen et Posner, 2012 ; Dosenbach et al., 2024).
Quant à la vitesse de traitement, elle est globalement associée à l’efficacité avec laquelle le cerveau transmet et transforme l’information. Il a été proposé qu’une grande partie de cette vitesse dépend de l’intégrité de la substance blanche et de la connectivité entre les régions cérébrales (Martin-Bejarano, 2024 ; Vercruyssen, 1993).
Par conséquent, les deux fonctions reposent sur des réseaux anatomiques et physiologiques distincts, et leur altération peut être due à des mécanismes physiopathologiques spécifiques.
Évaluation neuropsychologique de l’attention et de la vitesse de traitement
Dans le domaine de l’évaluation neuropsychologique, on peut également observer cette interaction étroite entre attention et vitesse de traitement. De nombreux tests initialement conçus pour évaluer différents composants de l’attention requièrent également de la rapidité dans les réponses.
Les résultats obtenus à des tests tels que le Trail Making Test (TMT) ou le test de Stroop ont traditionnellement été interprétés en termes d’altérations de composants attentionnels spécifiques. Mais ces résultats montrent un chevauchement entre les déficits de vitesse de traitement et les déficits attentionnels. Si un patient présente des problèmes de contrôle attentionnel, cela peut se traduire par une augmentation du temps de réponse. En même temps, une lenteur marquée dans le traitement peut être interprétée à tort comme une difficulté attentionnelle.
Si ces composants ne sont pas correctement évalués et distingués, il y a un risque de fixer un objectif thérapeutique erroné, avec la perte de temps, d’efforts et de ressources que cela implique (par exemple, en travaillant l’attention sélective alors que le véritable problème était une lenteur dans le traitement).
Dans ce sens, disposer de tests neuropsychologiques permettant d’établir correctement ces dissociations est d’une grande aide. Certains tests facilitent cette tâche. Ainsi, par exemple, le Symbol Digit Modalities Test (SDMT), l’indice de vitesse de traitement de la WAIS, ou le calcul de scores dérivés du TMT ou du Stroop permettent d’obtenir des indices de vitesse de traitement relativement indépendants du fonctionnement d’autres mécanismes cognitifs.
Cependant, il est nécessaire d’approfondir encore davantage les véritables causes d’une faible performance aux tâches. Ainsi, le modèle à trois facteurs de Costa et al. (2017) indique que, dans le cas de lenteur dans le traitement, il est aussi possible de distinguer si cette lenteur est sensorielle, cognitive ou motrice. Le neuropsychologue doit avoir la capacité et la prudence nécessaires pour évaluer correctement ces éléments. Disposer de tests spécifiques pour isoler correctement l’impact de chaque composant du traitement sera d’une grande aide pour délimiter le programme thérapeutique nécessaire pour chaque patient.
De nombreux neuropsychologues sont conscients de la nécessité d’opérer cette distinction, mais les outils disponibles actuellement exigent un travail supplémentaire de la part des professionnels qui, guidés par les théories cognitives disponibles, doivent rechercher l’existence de ces dissociations. Par conséquent, l’évaluation neuropsychologique doit évoluer vers des tests permettant d’isoler, autant que possible, chacune de ces fonctions pour poser un diagnostic différentiel précis (Arroyo et al., 2021 ; Lubrini et al., 2016 ; Lubrini et al., 2020).
En savoir plus sur
NeuronUP
Essayez-le gratuitement
La plateforme que plus de 4 500 professionnels utilisent chaque jour
Rééducation et stimulation
Enfin, une fois la cause principale des difficultés du patient identifiée, il est nécessaire de sélectionner des tâches permettant de travailler spécifiquement le composant affecté.
Ainsi, disposer d’exercices et d’outils d’intervention distincts pour les composants de l’attention et pour la vitesse de traitement facilitera grandement le travail quotidien du clinicien.
Une classification adéquate des activités de rééducation doit permettre de travailler les composantes attentionnelles sans pression temporelle, ou bien d’introduire un composant de vitesse nécessitant un rythme d’exécution élevé.
Il sera parfois souhaitable d’intégrer un composant attentionnel, ou une combinaison d’attention et de vitesse, voire des tâches de mémoire ou de fonctions exécutives, avec une pression temporelle élevée (ce qui facilitera l’apprentissage de stratégies pour gérer cette pression de manière plus généralisée).
Un plan de traitement rigoureux doit inclure des tâches spécifiques à chaque dimension, tout en tenant compte de l’influence mutuelle entre elles. Lorsqu’il est possible d’identifier clairement si une faible performance est due principalement à un déficit attentionnel ou à un ralentissement global, on peut concevoir des interventions thérapeutiques plus précises et efficaces.
Conclusion
En conclusion, les mécanismes attentionnels et la vitesse de traitement, bien qu’ils contribuent tous deux au comportement humain, reposent sur des réseaux neuroanatomiques partiellement distincts et nécessitent des stratégies d’évaluation et d’intervention également différenciées. Comprendre et évaluer correctement chaque fonction est l’une des clés d’un diagnostic précis et de la mise en œuvre d’interventions de rééducation efficaces en neuropsychologie.
Dans les années à venir, nous verrons comment les nouvelles technologies, l’intégration récente de l’IA et la puissance de calcul disponible actuellement faciliteront considérablement ce diagnostic différentiel et la conception de programmes toujours plus optimisés pour travailler les composants affectés, et, en fin de compte, pour prédire l’évolution et le pronostic fonctionnel des patients en rééducation.
Références
- Arroyo, A., Periáñez, J. A., Ríos-Lago, M., Lubrini, G., Andreo, J., Benito-León, J., Louis, E. D., & Romero, J. P. (2021). Components determining the slowness of information processing in parkinson’s disease. Brain and behavior, 11(3), e02031. https://doi.org/10.1002/brb3.2031
- Costa, S. L., Genova, H. M., DeLuca, J., & Chiaravalloti, N. D. (2017). Information processing speed in multiple sclerosis: Past, present, and future. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 23(6), 772–789. https://doi.org/10.1177/1352458516645869
- Donders, F. (1868–1869/1969). “Over de snelheid van psychische processen. onderzoekingen gedann in het physiologish laboratorium der utrechtsche hoogeshool,” in Attention and Performance, Vol. II, ed. W. G. Koster (Amsterdam: North-Holland).
- Dosenbach, Nico U. F., Marcus E. Raichle, and Evan M. Gordon. The brain’s cingulo-opercular action-mode network. PsyArXiv. 2024.
- John DeLuca, Jessica H. Kalmar (2008) Information Processing Speed in Clinical Populations. New York. Psychology Press
- Lubrini, G., Periáñez, J. A., Fernández-Fournier, M., Tallón Barranco, A., Díez-Tejedor, E., Frank García, A., & Ríos-Lago, M. (2020). Identifying Perceptual, Motor, and Cognitive Components Contributing to Slowness of Information Processing in Multiple Sclerosis with and without Depressive Symptoms. The Spanish journal of psychology, 23, e21. https://doi.org/10.1017/SJP.2020.23
- Lubrini, G., Ríos Lago, M., Periañez, J. A., Tallón Barranco, A., De Dios, C., Fernández-Fournier, M., Diez Tejedor, E., & Frank García, A. (2016). The contribution of depressive symptoms to slowness of information processing in relapsing remitting multiple sclerosis. Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England), 22(12), 1607–1615. https://doi.org/10.1177/1352458516661047
- Martín-Bejarano, M (2024) Correlatos neuroanatómicos de la velocidad de procesamiento de la información. Universidad de Cádiz.
- Petersen, S. E., & Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. Annual review of neuroscience, 35, 73–89. https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-062111-150525
- Posner, M. I., & Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual review of neuroscience, 13, 25–42. https://doi.org/10.1146/annurev.ne.13.030190.000325
- Ríos-Lago, M., & Periáñez, J. A. (2010). Attention and speed of information processing. In Encyclopedia of Behavioral Neuroscience, Three-Volume Set, 1-3 (Vol. 1, pp. V1-109).
- Ríos, M., Periáñez, J. A., & Muñoz-Céspedes, J. M. (2004). Attentional control and slowness of information processing after severe traumatic brain injury. Brain injury, 18(3), 257–272. https://doi.org/10.1080/02699050310001617442
- Salthouse T. A. (2000). Aging and measures of processing speed. Biological psychology, 54(1-3), 35–54. https://doi.org/10.1016/s0301-0511(00)00052-1
- Spikman, J. M., van Zomeren, A. H., & Deelman, B. G. (1996). Deficits of attention after closed-head injury: slowness only?. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 18(5), 755–767. https://doi.org/10.1080/01688639608408298
- Schneider, W., & Shiffrin, R. M. (1977). Controlled and automatic human information processing: I. Detection, search, and attention. Psychological Review, 84(1), 1–66. https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.1.1
- Vercruyssen, M. (1993) Slowing of behavior with age. In R Kastenbaum (Ed.). Enclyclopedia of adult development (pp 457-467). Phoenix Az. Oryx Press


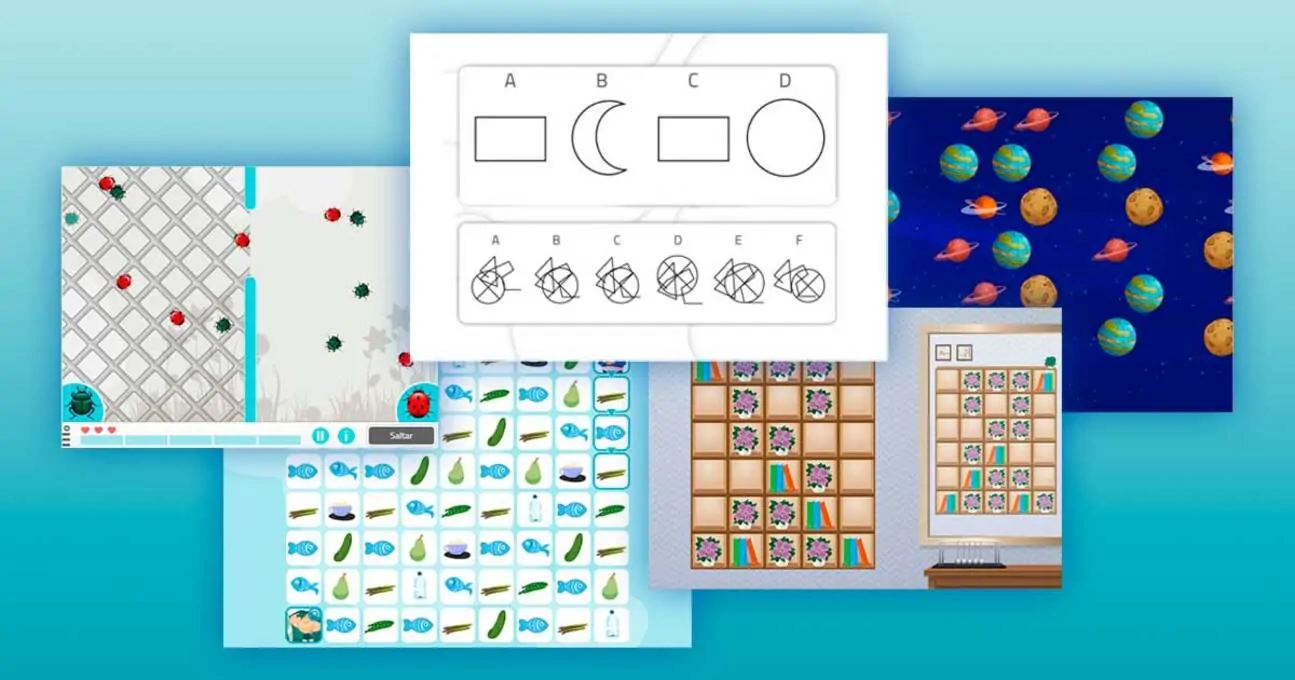
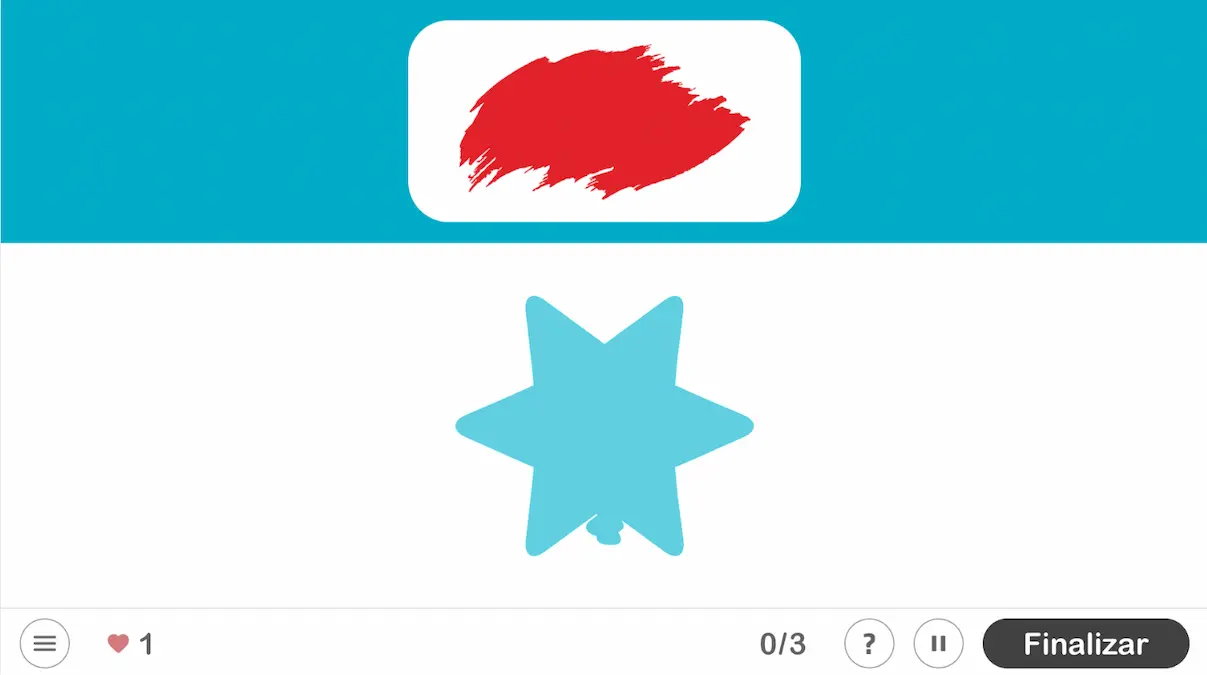


 Marcos Ríos-Lago, référence en neuropsychologie, rejoint NeuronUP
Marcos Ríos-Lago, référence en neuropsychologie, rejoint NeuronUP

Laisser un commentaire