Lidia García, neuropsychologue clinicienne et chercheuse, expose dans cet article en quoi consiste le phénomène de la confabulation, ainsi que sa classification, sa neuropathologie et ses mécanismes cognitifs.
Introduction
Les confabulations sont un phénomène cognitif qui apparaît dans divers troubles neurologiques acquis, mais aussi dans certains troubles psychiatriques.
Bien que le terme confabulation soit parfois utilisé aujourd’hui pour désigner de fausses perceptions corporelles ou du monde extérieur (confabulations non-mnésiques), il a traditionnellement renvoyé à des produits erronés de la mémoire (confabulations mnésiques)[1].
Il s’agit d’un phénomène complexe pour lequel il n’existe pas encore de définition consensuelle ni de critères solides de classification des différents types décrits, et dont les modèles explicatifs font toujours l’objet de débats [1, 2].
Cet article constitue le premier volume d’une série de deux publications sur le phénomène de la confabulation, dans laquelle seront brièvement passés en revue la phénoménologie, la neuropathologie ainsi que les mécanismes cognitifs et modèles théoriques proposés pour l’expliquer. Ce dernier point sera abordé dans le second volume de cette série.
Qu’entend-on par confabulation ? : concept et classifications
Depuis l’apparition du terme pour la première fois dans les travaux de Kahlbaum [3] et de Wernicke [4] vers la seconde moitié du XIXe siècle, de multiples définitions et interprétations lui ont été attribuées, ce terme ayant évolué avec le débat sur son étiologie et d’autres phénomènes cognitifs étroitement liés [2].
En général, la littérature a distingué trois concepts de confabulation, selon les aspects considérés en priorité :
- Le mnémonique, lié à la mémoire.
- Le linguistique, pour lequel l’essentiel réside dans la nature incorrecte de l’énoncé verbal ou du récit.
- Le épistémologique, où l’essentiel est que le patient ne remet pas en question l’affirmation infondée concernant quelque chose, et celle-ci n’est pas nécessairement de nature linguistique [1].
Une définition opérationnelle des confabulations proposée récemment [5] les décrit comme de faux souvenirs résultant d’un problème de récupération, dont le patient n’a pas conscience et en la véracité desquels il croit sincèrement. Selon cette conception, les confabulations se caractérisent par quatre aspects :
- Ils constituent de faux souvenirs dans le contexte de la récupération, qui contiennent souvent également des détails erronés dans leur propre contexte (ils peuvent consister en des souvenirs réels mal situés dans le temps, ou ne se fonder sur aucune réalité).
- Ils ne sont pas produits de manière intentionnelle, car le patient n’est pas conscient de confabuler et n’est souvent pas conscient de souffrir d’un déficit de mémoire, ce qui conduit à interpréter qu’ils ne résultent probablement pas de mécanismes compensatoires.
- Les patients peuvent agir en accord avec leurs confabulations, reflétant une croyance sincère dans le faux souvenir.
- Les confabulations se manifestent de manière plus évidente lorsqu’on sollicite un rappel autobiographique et, dans certaines conditions d’évaluation, peuvent également apparaître dans des tâches de mémoire sémantique [1].
Classifications de la confabulation
Quant à leur classification en différents types, plusieurs propositions ont également été formulées. Une classification largement acceptée aujourd’hui est celle de Kopelman [6], qui distingue les confabulations selon leur origine, les divisant ainsi en confabulations spontanées et confabulations provoquées.
- Les confabulations spontanées se caractérisent par leur rareté et leur association à un syndrome amnésique surimposé à une dysfonction frontale.
- Les confabulations provoquées sont fréquemment observées chez des patients amnésiques dans le cadre d’une évaluation, lorsqu’on leur administre des tests de mémoire.
Une autre classification populaire dans la littérature les distingue entre confabulations momentanées et fantastiques [1].
- Les confabulations momentanées sont décrites comme brèves, de caractère passager, provoquées « invariablement » par des questions mettant la mémoire à l’épreuve, et consistant en des souvenirs réels déplacés dans leur contexte temporel.
- Les confabulations fantastiques apparaissent de manière spontanée, sont affirmées avec conviction, de thématique variée et généralement grandioses, très perceptibles dans la conversation quotidienne des patients.
Neuropathologie des confabulations
Il existe une grande diversité de troubles dans lesquels se manifestent des confabulations ; des troubles tant acquis (par exemple, AVC, lésions cérébrales traumatiques, hypoxie avec arrêt cardiorespiratoire, etc.) que dégénératifs (démence), voire dans des affections psychiatriques telles que la schizophrénie et d’autres psychoses. Néanmoins, les deux troubles prototypiques où elles sont observées sont le syndrome de Korsakoff et l’hémorragie par rupture de l’artère communicante antérieure (ACoA) [1].
Dans le cas de la neuropathologie du syndrome de Korsakoff, il a été suggéré l’existence de deux systèmes dysfonctionnels : l’un constitué par la lésion des corps mamillaires et des noyaux antérieurs du thalamus, recevant des afférences de l’hippocampe via le fornix et associé à l’amnésie sévère caractéristique du trouble ; l’autre système dysfonctionnel incluant l’altération des noyaux dorsomédians du thalamus, qui entretiennent des connexions réciproques avec les zones médiales et orbitofrontales du cortex préfrontal, et reçoivent des afférences corticales et sous-corticales (amygdale et prosencéphale basal), lié à la production de confabulations [1].
Dans le cas de la pathologie due à l’hémorragie de l’ACoA, des études menées auprès de patients présentant un tableau amnésique et des confabulations ont mis en évidence des lésions dans le prosencéphale basal, le cortex préfrontal orbitofrontal et médial [1].
Une revue récente [1] conclut que, pour que les confabulations apparaissent, la lésion simultanée des aires ventromédiales et orbitofrontales du cortex préfrontal est nécessaire, tandis qu’une autre revue portant plus spécifiquement sur les confabulations spontanées [2] indique que les preuves actuelles identifient quatre zones impliquées dans ce type de confabulations : le cortex orbitomédial frontal et ses connexions avec l’amygdale, le gyrus cingulaire, le noyau dorsomédian du thalamus et l’hypothalamus médian.
Mécanismes cognitifs des confabulations
En synthèse, trois mécanismes cognitifs ont été proposés pour expliquer le phénomène de la confabulation, qui diffèrent essentiellement selon le degré d’implication du déficit de mémoire :
- Une dysfonction de la mémoire en tant que facteur primaire ou central, comme classiquement envisagé.
- Une dysfonction primaire des fonctions exécutives, considérée comme condition nécessaire et suffisante à l’apparition de confabulations.
- Hypothèse duale : une combinaison de déficit de mémoire et de dysfonction exécutive.
Actuellement, il semble que l’évidence penche en faveur de l’hypothèse duale [1], selon laquelle les confabulations ne seraient pas le résultat d’un mécanisme compensatoire dû à un déficit de mémoire ou une amnésie primaire, mais la conséquence d’un certain degré d’altération des systèmes mnésiques et d’un certain degré de dysfonction dans les processus exécutifs.
Néanmoins, il reste à élucider quelle est la contribution spécifique des déficits mnésiques et celle des fonctions exécutives dans la production des confabulations et selon leur type.
Une question à souligner ici est que les différentes études sur le sujet ont utilisé des tests de mémoire et des évaluations de fonctions exécutives variés, qui examinent divers processus exécutifs et diffèrent selon les sous-systèmes mnésiques, rendant pratiquement impossible la comparaison des résultats pour établir des conclusions.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Bibliographie
- Lorente-Rovira E, Berrios G, McKenna P, Moro-Ipola M y Villagrán-Moreno JM (2011). Confabulaciones I: concepto, clasificación y neuropatología. Actas EspPsiquiatr, 39(4):251-9.
- Glowinski R,Payman V &Frencham, K. (2008). Confabulation: a spontaneous and fantasticreview.Australian and New ZealandJournal of Psychiatry, 42:932-940.
- Kahlbaum K (1863). Die Gruppierung der psychischenKrankheitenund die Eintheilung der Seelenstörungen. Danzig: AW Kafemann (Part III, trans. Berrios GE, HistPsychiatry1996; 7:167181.)
- Wernicke K(1906).Grundriss der Psychiatrie, 2nd edn. Liepzig: Thieme.
- Gilboa A, Alain C, Stuss DT, Melo B, Miller S, Moscovitch M. (2006). Mechanisms of spontaneousconfabulations: a strategicretrievalaccount. Brain, 129:1399-414.
- Kopelman MD (1987). Twotypes of confabulation. JNeurolNeurosurgPsychiatry, 50:1482-7.


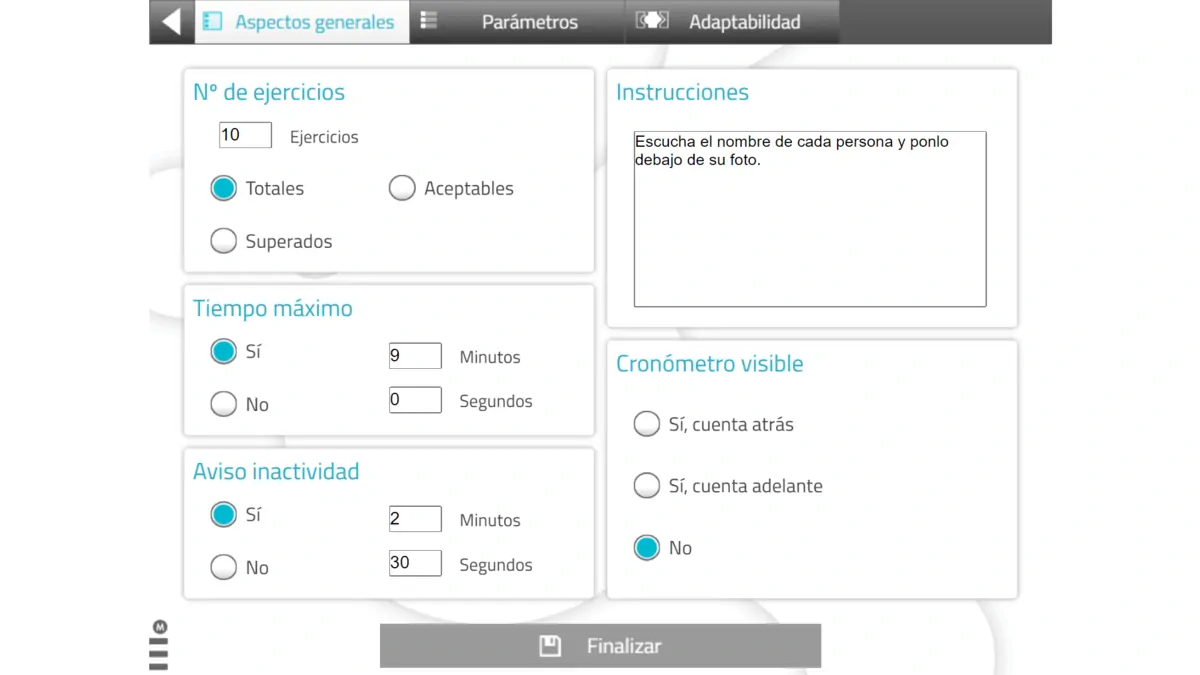
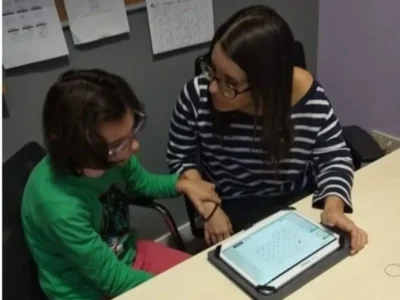



 Entraînement cognitif-moteur : utilisation de tâches duales, réalité virtuelle et réalité augmentée
Entraînement cognitif-moteur : utilisation de tâches duales, réalité virtuelle et réalité augmentée

Laisser un commentaire