Le neuropsychologue clinicien David de Noreña répond aux questions concernant son intervention Approche non pharmacologique du patient neurologique agité réalisée le 18 janvier dernier à NeuronUP Academy.
Questions concernant l’intervention Approche non pharmacologique du patient neurologique agité de David de Noreña
1. Yolanda Higueras : Dans le cas de patients présentant des troubles de la compréhension du langage, quelles outils non verbaux pourrions-nous utiliser ? Lesquels seraient les plus efficaces ? Merci David, super intéressant et je suis totalement d’accord avec Mafalda !
À titre préventif (contrôle des antécédents), nous pouvons faire beaucoup de choses même en cas d’altérations du langage. Par exemple, mettre en place des routines qui permettent d’anticiper au patient ce qui va se passer ensuite, fournir une stimulation cognitive –et sociale– minimale, et nous assurer qu’il n’a pas de douleur, d’inconfort, de faim, etc., qui pourrait influencer son comportement.
Bien sûr, les altérations du langage (ou son absence) rendent plus difficile la communication de nos intentions lors de l’intervention (c’est-à-dire expliquer les consignes et le programme de modification du comportement) et, également, réduisent la capacité d’autorégulation du patient.
2. Beatriz Moreno : J’ai un cas concret dans la résidence où je travaille. Que faire lorsque le patient a des problèmes d’audition, comprend ce qu’on lui explique, ne sait pas exprimer ses besoins et, en plus, ne participe pas aux activités qui aideraient à prévenir ces comportements agités ? Merci beaucoup, j’ai adoré le webinaire !
Comme je l’ai expliqué à une autre de vos collègues, à titre préventif (contrôle des antécédents), nous pouvons faire beaucoup de choses même en cas d’altérations du langage ou de troubles auditifs comme ceux que vous mentionnez. Par exemple, mettre en place des routines qui permettent d’anticiper au patient ce qui va se passer ensuite, fournir une stimulation cognitive –et sociale– minimale, et nous assurer qu’il n’a pas de douleur, d’inconfort, de faim, etc., qui pourrait influencer son comportement.
Dans un cas comme celui-ci, il serait en outre important, en plus du contrôle des antécédents, de mettre en place un type de programme opérant (ex. : renforcement différentiel chaque fois qu’il participe, reste dans un lieu déterminé, etc.).
3. Abigail Mariscal : Je souhaite connaître des stratégies de prévention, avez-vous du matériel que je pourrais consulter ?
https://consaludmental.org/publicaciones/Apoyoconductualpositivo.pdf
http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3404
4. Verónica Alonso : Comment devrions-nous agir lorsque le patient se réveille agité pendant la nuit ?
Comme je l’ai souligné lors de la conférence, bien que l’approche soit différente pour chaque cas, il y a une chose que nous devons essayer de faire avec tous les patients, à savoir comprendre quelle est la cause de l’agitation (qu’ils puissent ou non l’exprimer).
Généralement, l’agitation nocturne sera conditionnée par la désorientation, c’est pourquoi il est très important de tranquiliser le patient et de l’orienter sur le lieu où il se trouve, sur ce que nous allons faire ensuite, etc., à condition d’écarter d’autres causes plus « physiologiques » (ex. : douleur, inconfort, etc.).
5. Julen Chato Noriega : Pour des patients atteints de troubles psychiatriques d’âge moyen qui s’enhardissent lorsqu’on applique l’extinction, auriez-vous un conseil ? Merci !
Lorsque nous sommes face à un patient présentant des conduites défiantes comme vous le décrivez, nous devons réaliser une bonne analyse fonctionnelle pour déterminer à la fois les déclencheurs habituels (ex. : personnes, contextes, etc.) et les renforcements possibles du comportement (ex. : les rires ou l’attention d’autres patients, la réprimande de l’aide-soignant, etc.). Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons utiliser les techniques les plus appropriées dans chaque cas. L’extinction, comme je l’ai mentionné lors de la conférence, ne devrait pas être appliquée à des comportements potentiellement dangereux, qui nécessiteront d’autres techniques opérantes (ex. : coût de réponse).
6. Carlos Corzo : Bonjour et merci pour le webinaire. Que se passe-t-il lorsque nous sommes face à des cas cognitivement plus préservés (lésion cérébrale plus chronique), disposant d’une plus grande autonomie (vit seul), orientés, mais souffrant d’importants troubles dysexécutifs et de difficultés dans la régulation de l’agressivité ? Quelles démarches pourraient être applicables ou quelle autre approche non pharmacologique pourrait aider ?
Comme je l’ai expliqué lors de la conférence, les principaux outils du neuropsychologue seront la valorisation cognitive d’une part, et l’analyse fonctionnelle d’autre part. Autrement dit, nous devons évaluer dans quels contextes se produit ce comportement et à quelle fréquence (ex. : avec quelles personnes, face à quelles demandes) ainsi que quels facteurs peuvent le maintenir (ex. : on cesse de lui demander des choses qu’il n’apprécie pas, il obtient de l’attention sociale, etc.).
L’approche sera, bien sûr, comportementale, mais dans un cas comme celui-ci, nous devrions également pouvoir la combiner avec un entrainement aux techniques de régulation de l’irritabilité (ex. : techniques de relaxation) et travailler la prise de conscience des difficultés et des implications des comportements avec le patient lui-même, afin d’accroître sa collaboration.
Voici un lien vers un manuel assez accessible qui peut vous donner quelques pistes sur la manière d’aborder certains problèmes cognitifs et comportementaux : http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3404
7. Daira García : Bonsoir, merci pour votre exposé. Ma question est la suivante : considérez-vous que certaines des activités que vous avez mentionnées, comme recevoir la lumière du soleil ou marcher, sont parfois plus bénéfiques qu’un traitement pharmacologique ? Ou constituent-elles plutôt une alternative préventive ?
C’est une bonne question, à laquelle il est difficile de répondre. J’estime que cela dépendra de chaque cas. De manière générale toutefois, je pense qu’il est éthique de commencer par des techniques ou des procédures moins invasives telles que les approches comportementales et, lorsque celles-ci ne sont pas suffisantes, l’approche pharmacologique viendra en complément.
8. Verónica Sánchez : Comment agir lors d’une attaque de panique ? Et comment aider à contenir les symptômes d’anxiété ?
La réponse la plus honnête est que cela dépendra de la situation cognitive de chaque patient. En cas d’attaque de panique, avant tout, nous devons éviter que le patient se blesse ou n’accroisse encore son anxiété, ce qui implique généralement de rester à ses côtés, essayer de le tranquilliser et de le guider gentiment pour qu’il réduise sa agitation sur le moment. Par exemple, lui demander de respirer lentement, lui donner un verre d’eau, lui permettre de bouger un peu, etc.
En ce qui concerne l’anxiété, il existe de nombreuses techniques que nous pouvons enseigner au patient, depuis la respiration abdominale jusqu’à la relaxation progressive, en passant par d’autres liées au mindfulness. Cependant, comme je vous le disais, cela dépendra de chaque patient et de sa situation cognitive.
9. Nastra Ares : Tout ce que vous avez dit est très intéressant. Vous avez parlé d’activité physique quotidienne pour prévenir l’agitation : et des activités cognitives ?
Bien sûr, stimuler le patient par des activités cognitives ou par des moments d’interaction avec d’autres personnes améliorera sa satisfaction et sa participation et aidera donc à réduire les comportements problématiques.
Il est vrai que l’activité physique, qui peut être réalisée même avec des patients très détériorés, intègre un composant irremplaçable qui entraîne généralement une réduction de la tension interne et est donc très utile chez les patients présentant une agitation psychomotrice ou ayant tendance à déambuler ou à s’auto-stimuler par des mouvements stéréotypés.
Si vous avez apprécié cet article sur les questions de l’exposé Approche non pharmacologique du patient neurologique agité de David de Noreña, ces informations pourraient également vous intéresser :



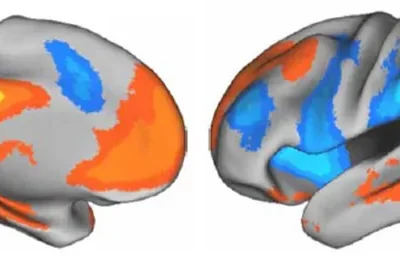
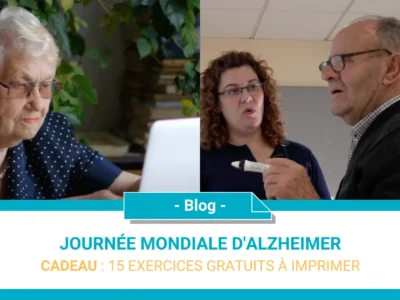

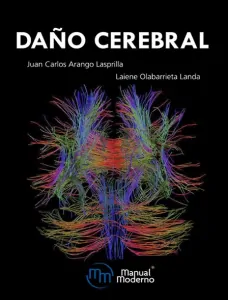

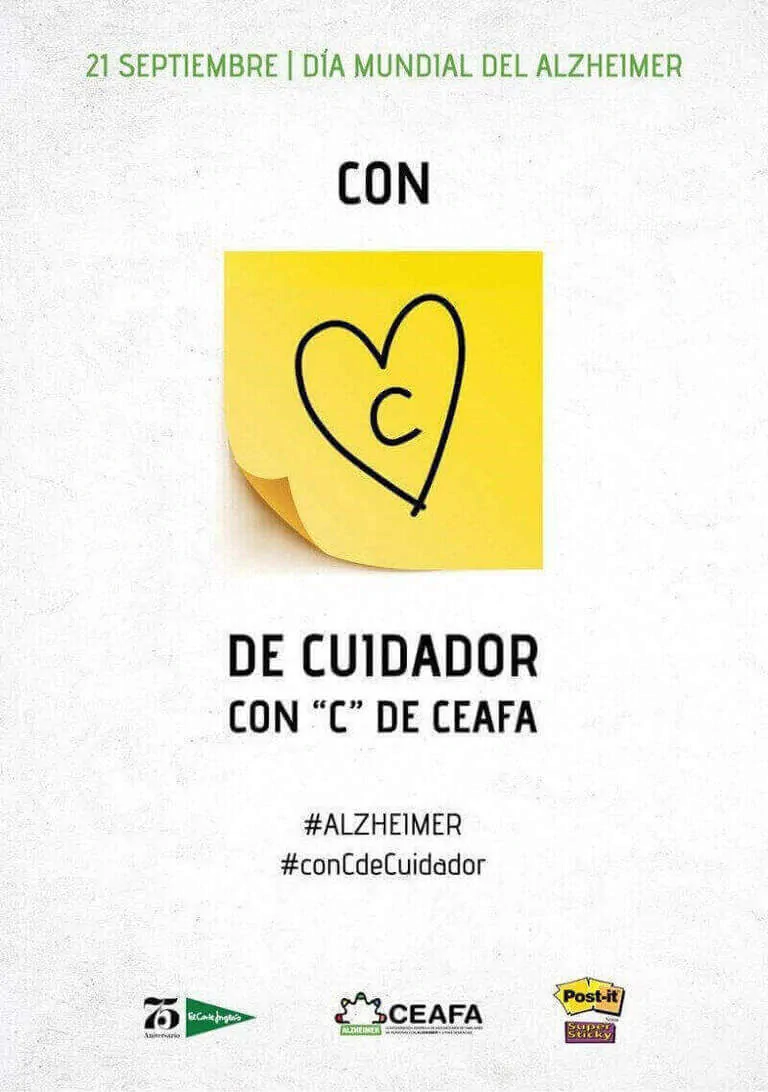
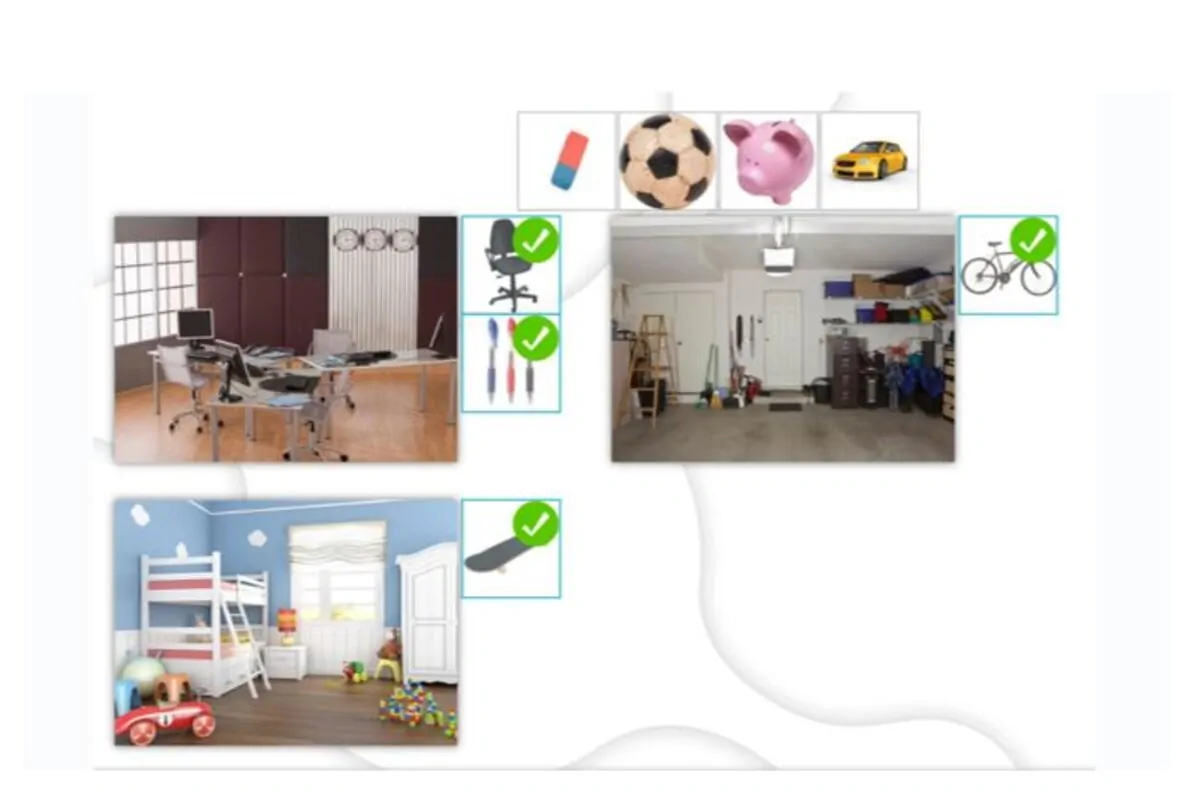 Orientation : définition, types et activités d’orientation
Orientation : définition, types et activités d’orientation

Laisser un commentaire