Le docteur en biomédecine Pablo Barrecheguren nous explique le rôle des organoïdes en tant que l’une des techniques les plus importantes de la recherche biomédicale.
L’un des plus grands obstacles auxquels la neuroscience est confrontée est la difficulté d’obtenir des informations in vivo sur un cerveau humain.
Il existe certes des techniques, comme la résonance magnétique fonctionnelle ou l’implantation d’électrodes intracrâniennes, qui nous permettent d’obtenir des informations sur l’activité cérébrale…, mais le véritable défi se situe au niveau moléculaire : pouvoir analyser le développement et l’interconnexion cellulaire en temps réel, car jusqu’à présent les possibilités se limitent majoritairement à des études post mortem ou à des cultures cellulaires dont les résultats, bien souvent, ne peuvent être extrapolés au comportement global d’un cerveau humain. Pour relever ce défi, l’une des meilleures options est l’utilisation d’organoïdes cérébraux.
Organoïdes cérébraux
Qu’est-ce que les organoïdes
Les organoïdes sont des agrégats cellulaires autoassemblés formés à partir de cellules souches, et qui ont pour caractéristique principale de reproduire, dans une certaine mesure, l’architecture et la composition cellulaire de l’organe visé.
Initialement, l’un des domaines de recherche concernait la création d’organoïdes reproduisant les épithéliums intestinaux, mais à ce jour la technique s’est étendue à d’autres organes, l’un des domaines les plus intéressants étant les organoïdes cérébraux.
Méthodes de fabrication des organoïdes
Il existe deux principales méthodes pour les fabriquer :
- Techniques non guidées : partent de cellules souches pluripotentes humaines cultivées in vitro en limitant au maximum l’utilisation de signaux biochimiques externes dirigeant la croissance. Cela entraîne une grande variabilité qui, dans certains cas, conduit à la formation d’organoïdes dont la composition cellulaire est assez similaire à celle d’un cerveau humain en développement.
- Techniques guidées : elles partent de la même base mais avec une plus grande intervention dans le développement de l’organoïde par l’utilisation de biomolécules. Cela permet de produire des organoïdes beaucoup plus spécifiques, dont les compositions cellulaires imitent celles de zones précises d’un cerveau humain en développement.
En général, ces organoïdes parviennent à reproduire, dans une certaine mesure, la composition cellulaire et la structure d’un cerveau humain. De plus, les données d’analyse de l’expression génétique de ces organoïdes, dans leur ensemble, coïncident partiellement avec celles d’un cerveau humain en développement.
Limitations de ces modèles
Cependant, il ne faut pas oublier que ces modèles présentent malgré tout plusieurs limitations très importantes, telles que :
- Les organoïdes présentent une taille très réduite. Ils mesurent environ 4 mm, alors que le cortex cérébral humain seul atteint environ 15 cm de diamètre. Cette situation engendre de nombreuses différences structurelles qui distinguent nettement un organoïde d’un cerveau humain.
- Ils ne développent aucune vascularisation. Les organoïdes cérébraux ne possèdent pas de vaisseaux sanguins per se, et même lorsqu’ils sont cultivés avec des cellules épithéliales, la création de capillaires fonctionnels dans le tissu n’a pas été obtenue. L’absence de vaisseaux constitue déjà une grande différence structurelle, mais elle génère également un problème supplémentaire : l’organoïde ne peut acquérir des nutriments que par sa surface extérieure, ce qui fait qu’à un certain stade de croissance, les cellules situées dans les parties les plus profondes de l’organoïde développent une nécrose par manque de nutriments.
- Les cellules de l’organoïde reproduisent l’état cellulaire d’un cerveau en développement, de sorte que les informations qu’ils peuvent nous fournir sur un cerveau adulte ou même âgé sont limitées.
Technique importante en recherche biomédicale
Pourtant, malgré toutes ces limitations, les organoïdes se présentent comme l’une des techniques les plus importantes de la recherche biomédicale pour trois raisons.
- Premièrement, il faut prendre en compte qu’ils sont fabriqués à partir de cellules souches pluripotentes, et qu’actuellement ce type cellulaire peut être obtenu directement ou à partir de cellules adultes qui sont ensuite reprogrammées en laboratoire (par exemple à partir d’un échantillon de cellules sanguines, reprogrammées par la suite pour devenir ce que l’on appelle des cellules souches pluripotentes induites). Cela a permis de créer des organoïdes reproduisant des malformations congénitales telles que la microcéphalie, ou même d’utiliser des organoïdes avec des cultures virales pour étudier les effets neuronaux du virus Zika.
- Deuxièmement, ces modèles servent à étudier le développement cérébral et des affections cliniques telles que la schizophrénie ou les troubles du spectre autistique sont déjà étudiées.
- Et troisièmement, on peut créer des organoïdes cérébraux d’autres animaux, ce qui facilite la réalisation d’études évolutives comparant différentes espèces.
Actuellement, les organoïdes cérébraux sont des outils de recherche très précieux et les travaux les combinant avec d’autres techniques ont un grand potentiel.
Cependant, lorsqu’on lit des articles publiés dans ce domaine, il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’un modèle d’expérimentation et, malgré le fait qu’on les appelle “cerveaux en miniature”, ils présentent également de nombreuses différences essentielles par rapport à un cerveau humain adulte.

Abonnez-vous
à notre
Newsletter
Bibliographie
- Elizabeth Di Lullo and Arnold R. Kriegstein. The use of brain organoids to investigate neural development and disease. Nat Rev Neurosci. 2017 October; 18(10): 573–584
- Harpreet Setia, Alysson R. Muotri. Brain organoids as a model system for human neurodevelopment and disease. Seminars in Cell and Developmental Biology (2019)
- Xuyu Qian, Hongjun Song and Guo-li Ming. Brain organoids: advances, applications and challenges. Development (2019) 146, dev166074
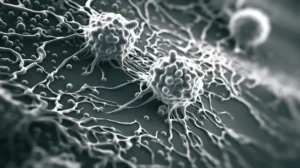
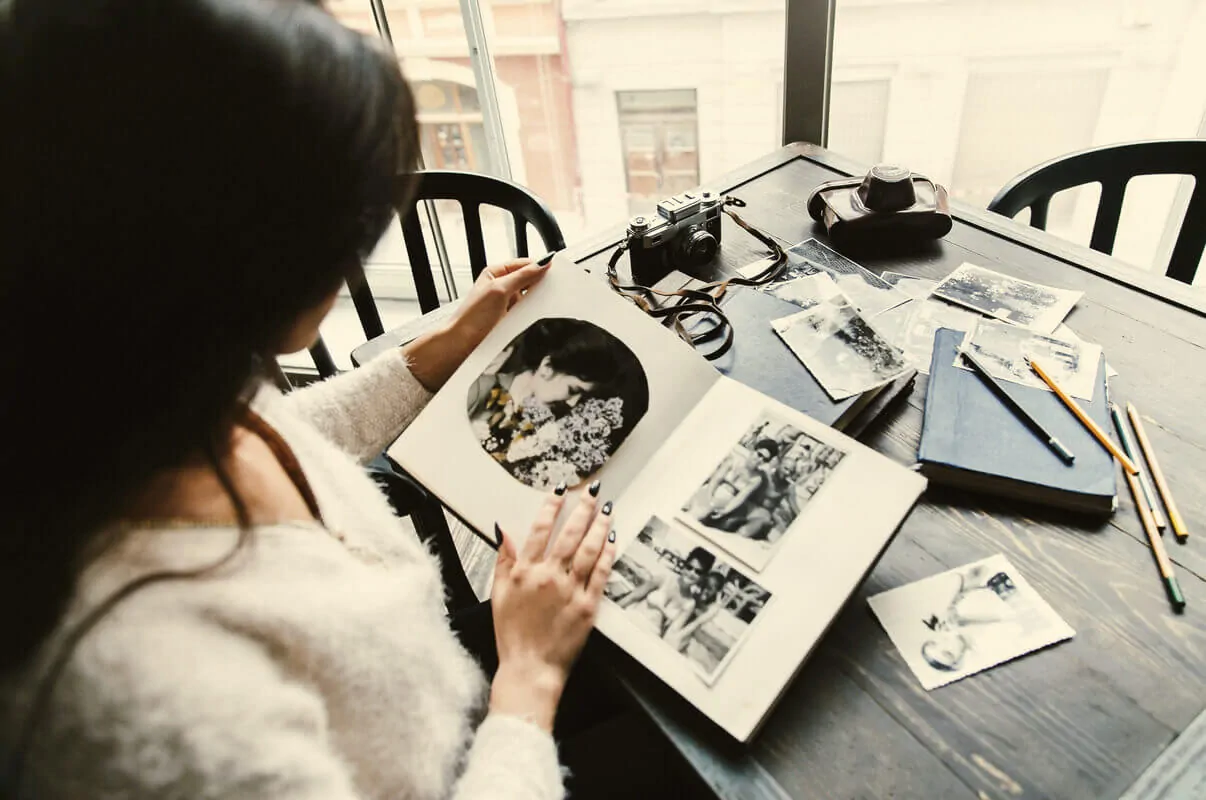 Tout sur la mémoire
Tout sur la mémoire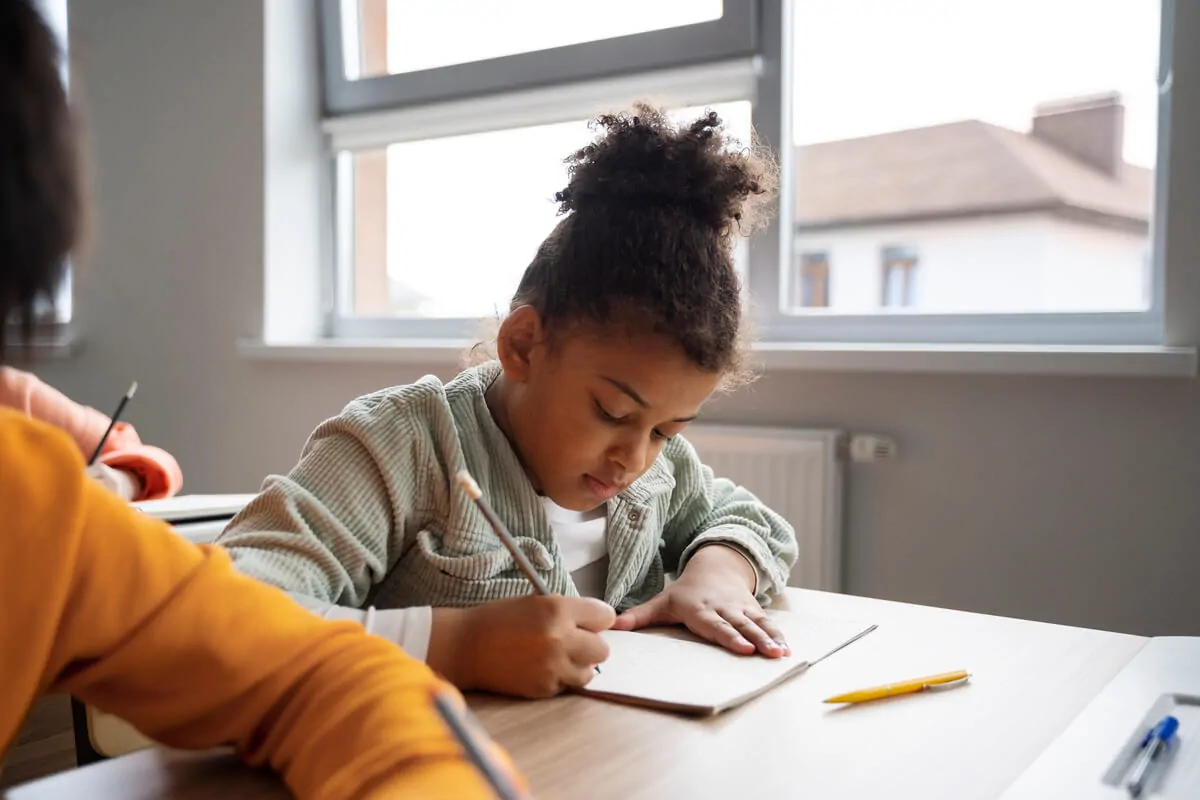

Laisser un commentaire